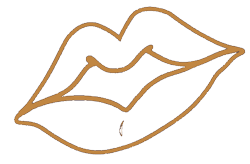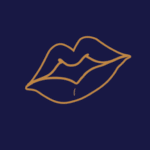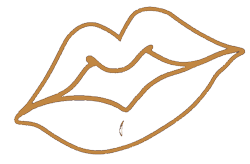Il suffit de se placer à l’angle du boulevard Haussmann pour sentir que quelque chose, cette année, a légèrement glissé dans l’air de Noël. Le Printemps n’a pas seulement allumé ses guirlandes : il a déplacé un morceau d’Amérique jusque dans ses vitrines. Pas la version saturée de clichés, ni celle de la skyline démultipliée en magnets, mais un New York rêvé, condensé, tamisé par l’artisanat et la narration. Une ville recomposée pour la vitrine, qui emprunte autant au cinéma qu’aux pages du New Yorker.
La scène inaugurale, le 6 novembre, a donné le ton. Diane Kruger, silhouette claire dans la nuit parisienne, est venue ouvrir la saison. Une actrice, un flash, un ruban tranché : le protocole est connu. Ce qui l’est moins, c’est ce que cette présence signifie. Car entre le Printemps et New York, l’histoire a pris un tournant décisif : en mars, l’enseigne française a ouvert sur One Wall Street, art déco monumental face au quartier financier. Alors les vitrines 2025 ne sont pas un simple décor : elles sont une déclaration d’intention.
Une ville miniature, peuplée de chiens voyageurs

Devant les vitrines, le public découvre un cortège inattendu : une bande de chiens explorateurs, 125 personnages animés, sculptés à la main dans des matériaux naturels et recyclables. Une petite société canine qui traverse Manhattan comme d’autres traverseraient un roman. Les chiens grimpent les marches du MET, croisent les taxis jaunes, s’arrêtent sous les lampes de Times Square, slaloment dans le brouhaha de Broadway.
L’idée peut paraître légère, presque enfantine. Elle cache pourtant un solide travail d’artisanat : des centaines d’heures de découpe, de couture, de montage. Le choix du matériau, carton, tissu, éléments recyclés, correspond à une volonté affichée de rendre Noël plus durable, ou du moins de désamorcer la critique qui pèse sur l’esthétique déployée chaque année, souvent aveuglante en énergie et en plastique.
La direction artistique, elle, puise dans un univers graphique précis : celui des comics du New Yorker.
Lignes nettes, aplats noirs et blancs, silhouettes stylisées : l’ensemble évoque Broadway vu depuis un carnet de croquis. Chaque scène ressemble à une planche de bande dessinée que le passant lirait en marchant, dans un brouillard léger de lumières et de respiration.
Devant le Printemps, les passants s’agglutinent : familles, touristes, habitués du quartier, cadres pressés qui ralentissent d’un coup en apercevant un automate en mouvement. Chaque année, la foule se soude ici, comme sur un quai où l’on attend quelque chose qui ne viendra jamais tout à fait, peut-être une enfance, peut-être un rêve.
Et dans un Paris marqué par les travaux, les tensions urbaines et la crainte diffuse de la crise énergétique, les vitrines jouent un rôle discret mais réel : celui d’un apaisement social. Une sorte de micro-harmonie urbaine, offerte gratuitement, où chacun peut s’attarder quelques minutes sans justification.
Une patinoire en or suspendue sur les toits


L’expérience ne se limite plus à la rue. Depuis quelques années, le Printemps développe des dispositifs immersifs, destinés à prolonger la visite. Cette année, l’événement phare est sans doute la patinoire “New York by Ferrero Rocher”, installée au 7ᵉ étage. Une piste d’une centaine de mètres carrés, une pyramide dorée en hommage à la marque, et une vue ouverte sur les toits gris de Paris. On patine ici comme on le ferait à Central Park : entre maladresse et enthousiasme, dans un décor qui embrasse les codes de la comédie romantique américaine.
Le geste n’est pas qu’esthétique. Il répond à une nécessité : les grands magasins ne vendent plus seulement des biens, mais des expériences. Face à la montée du e-commerce, les enseignes doivent se réinventer, proposer des raisons de venir, de rester, de revenir. La patinoire, gratuite sur inscription, incarne cette stratégie : offrir un moment, et pas seulement une marchandise.
New York, miroir de Paris

Alors pourquoi New York ? Parce que la ville fonctionne comme un double fantasmatique. Paris la regarde comme une sœur de lumière : même densité, même verticalité symbolique, même capacité à produire de l’imaginaire. En choisissant Manhattan comme thème, le Printemps raconte autant la ville américaine que sa propre ambition : celle d’un grand magasin qui s’exporte, assume son héritage et s’autorise, une fois par an, une fiction à grand spectacle.
Et surtout, parce que New York reste un refuge narratif pour une époque saturée de quotidien. Ici, l’Amérique n’est pas politique, elle est poétique. Elle est réduite à une série de signes, taxis jaunes, escaliers du métro, façades en briques, neige quasi permanente, et ces signes suffisent à créer une autre géographie mentale pour les passants qui traversent le boulevard.
Plus d’infos :
Crédits : Francis Peyrat