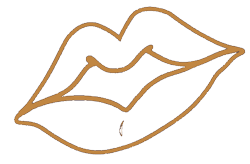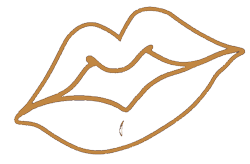En France, les histoires de plagiat, c’est comme les dîners du 7ᵉ arrondissement : tout le monde sait, personne ne parle, sauf quand ça éclate dans la presse. Et encore. Quand Le Monde s’y colle, ça donne un titre avec Musso en majuscules et Diana Katalayi Ilunga Ilunga réduite à « une autrice ». La star en vitrine, la plaignante en note de bas de page.
L’histoire ? Simple. En 2021, Katalayi Ilunga autoédite Et tu ne le sais pas. Héroïne dans le coma, médecin-passeur, twist qui retourne le lecteur. En 2022, elle envoie son manuscrit à Calmann-Lévy. Deux ans plus tard, chez le même éditeur, Guillaume Musso publie Quelqu’un d’autre. Et là, surprise : même structure narrative, même tableau médical, même coup de théâtre. La coïncidence a bon dos. L’avocat de la romancière, Jim Michel-Gabriel, parle de « contrefaçon littéraire ».
Mais ce n’est pas qu’une affaire de phrases qui se ressemblent. C’est une affaire de qui a le droit d’accuser qui. Les femmes dans l’édition française connaissent la chanson : quand elles dénoncent, ça s’appelle un coup de com’ ; quand ce sont des auteurs établis qui se plaignent, c’est de la défense de patrimoine.
Les précédents ? Outre-Atlantique Barbara Chase-Riboud contre Spielberg (Amistad), fin étouffée par un accord. Ashanti accusée d’avoir recyclé le livre d’une autre Afro-Américaine. Pas de procès, mais un bûcher médiatique allumé sur Instagram. Pendant ce temps, en France, Alain Minc, condamné deux fois pour pompage, continue d’être invité sur les plateaux. Houellebecq, lui, est en route vers un procès pour plagiat, après avoir écrit un roman très ressemblant à un manuscrit refusé. Je vous raconte. Houellebecq est rattrapé par El Hadji Diagola et son Un musulman à l’Élysée, que Gallimard et Flammarion avaient snobé avant qu’un roman étrangement proche ne paraisse, celui de Houellebecq en l’occurrence. Eux, hommes médiatiques, trouvent audience et réparations morales.
C’est ça, la littérature : un double standard. Les hommes, déjà assis au banquet, obtiennent réparation. Les autres ? Les femmes, crient plus fort, tweetent plus fort, écrivent plus fort, pour juste exister dans le débat. Parce que dans ce petit cercle, le plagiat n’est pas qu’une affaire de phrases volées : c’est une question d’accès, de capital symbolique, de genre, voire de peau et de réseaux. Les femmes elles, doivent passer par la rue, les réseaux, les hashtags, et espérer qu’un juge daigne tendre l’oreille.
Le plagiat, ici, est un thermomètre : il mesure moins le talent que la place que l’on vous laisse. Et si l’affaire Katalayi Ilunga-Mussso va jusqu’au bout, elle pourrait fissurer le mur de l’invisibilité. Dans le club germanopratin, l’« inspiration » est un hommage quand elle vient d’en haut, un délit quand elle remonte d’en bas. Si elle va jusqu’au bout donc, elle pourrait faire sauter un verrou. Sinon, elle rejoindra le cimetière des plaintes enterrées, avec pour épitaphe : « Manque de notoriété ».