Dans la jungle de la Silicon Valley, dire non à Mark Zuckerberg, c’est comme refuser une tournée offerte par Keith Richards : ça ne se fait pas… sauf si on s’appelle Mira Murati. Ingénieure albano-américaine, 37 ans, cerveau d’acier trempé et sourire tranquille, elle vient de claquer la porte au nez de Meta, qui lui proposait un chèque à neuf zéros pour embarquer son équipe. Un milliard sur la table, et elle dit : “non, merci” !
Vous vous souvenez de cette pub culte de la Française des Jeux, début 2000, où un type déguisé en poulet claque la porte à son patron, micro à la main, avec un “Au revoir, président !” jubilatoire ? Eh bien, Mira Murati vient de faire exactement ça… mais version Silicon Valley. Pas de costume de gallinacé, pas de micro HF, juste un milliard de dollars posé sur la table et un sourire qui dit : gardez la monnaie.
Zuckerberg, persuadé de pouvoir aligner les zéros comme on aligne des dominos, a dû se prendre la claque du siècle. Pas parce que Murati est partie, mais parce qu’elle n’est pas venue. Elle a regardé le jackpot droit dans les yeux, et elle a dit : mon projet vaut plus que votre chèque. L’ingénieure albano-américaine, cerveau câblé haute tension, a refusé cette fameuse offre à neuf zéros de Mark Zuckerberg. Oui, refusé. Dingue ? Non, on vous explique pourquoi.
L’offre qui valait un milliard
On connaît les visages en vitrine de la Silicon Valley : Sam Altman et son sourire en coin, Aravind Srinivas, le patron de Perplexity qui parle comme s’il voulait réécrire Wikipédia à lui tout seul. Mais il y a aussi les autres, les silhouettes de l’ombre. Et parfois, elles sortent du bois.
Juin dernier. Zuckerberg fait son marché comme on chine des vinyles rares : il veut les meilleures têtes d’OpenAI, quitte à allonger. Meta ratisse large pour muscler son projet Superintelligence Lab. Chèques en blanc, promesses d’actions en or massif : jusqu’à un milliard de dollars sur la table pour embarquer l’équipe de Thinking Machines Lab, la start-up de Murati.
Le genre d’offre qui fait tourner la tête, même aux cerveaux les mieux vissés. Les lieutenants de Murati ? Courtisés, bichonnés, prêts à être empaquetés avec ruban doré. Sauf que non. Murati et ses troupes ont décliné, poliment mais fermement. Fidélité à une vision, ou allergie à l’odeur du fric trop facile ? La question reste ouverte. Dans un monde où on vend son âme pour moins que ça, ça frôle l’insolence.
De l’Albanie à la Silicon Valley
Née en 1988 en Albanie, Mira Murati file vers les États-Unis pour un diplôme d’ingénieure en mécanique à Dartmouth. Premier job chez Zodiac Aerospace, puis Tesla où elle bricole sur le Model X, la voiture qui se prend pour un vaisseau spatial. En 2018, elle atterrit chez OpenAI, grimpe les échelons jusqu’au fauteuil de directrice technique, pilote ChatGPT et DALL·E, et devient PDG intérimaire pendant le psychodrame du départ-éclair de Sam Altman en 2023. Suffisant pour que son nom circule dans tous les open spaces qui comptent. Dans les couloirs, on murmure qu’elle était “la tête pensante derrière ChatGPT”.
L’éthique, pas la hype
En février 2025, Elle claque la porte d’OpenAI. Pas pour aller bronzer à Hawaï, mais pour monter Thinking Machines Lab, une boîte qui promet une IA “éthique et accessible”. Un slogan qui sonne comme du Rage Against the Machine pour geeks. Et pourtant, moins d’un an plus tard, levée de fonds record : 2 milliards de dollars, valorisation à 12 milliards, sans produit en rayon. Forcément, ça attire les prédateurs. Mais Murati, elle, joue la montre. Du grand art.
Zuck 0 – Murati 1
Une femme qui dit non à Zuckerberg, c’est rare. Une femme qui le fait avec un sourire tranquille, c’est encore plus rare. Et c’est peut-être ça, le vrai pouvoir. Murati vient de réécrire le scénario. Pas le poulet qui s’enfuit, mais la chef d’orchestre qui reste sur scène.
Dans un écosystème où la hype et le cash dictent tout, elle joue une autre partition. Dire non à Zuckerberg, ce n’est pas juste refuser un milliard : c’est envoyer un message. Qu’il existe encore, quelque part, des gens qui ne négocient pas leur vision au kilo. Et ça, en 2025, dans la Silicon Valley, c’est un kiff total.
Sources :

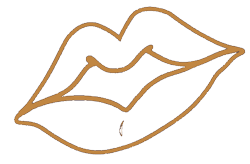










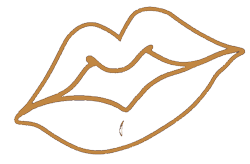
Wow incroyable article ❤️🔥