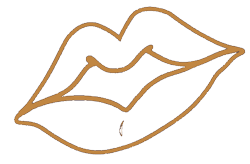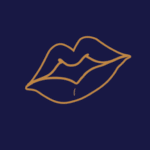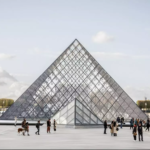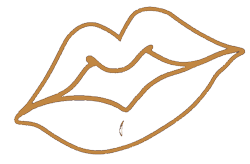Il y a des dons qui ressemblent à des pied de nez, et qui font plus de bruit qu’un discours de président. Celui de MacKenzie Scott, ex-épouse du fondateur d’Amazon et troisième fortune mondiale féminine, en est un magistral. La romancière et philanthrope américaine récemment entrée dans la « super-ligue » des mécènes milliardaires, a fait un don pour la deuxième fois de 40 millions de dollars pour la préservation du patrimoine afro-américain aux États-Unis. Là où des milliardaires bâtissent des musées à leur gloire, elle finance la mémoire de ceux que la nouvelle administration Trump veut rayer des manuels d’histoire.
Mercredi 15 octobre, l’ex épouse de Jeff Bezos, a signé un chèque vertigineux versé à l’African American Cultural Heritage Action Fund, le plus grand programme américain dédié à la préservation du patrimoine afro-américain. Des églises noires, des écoles de la ségrégation, des clubs de jazz de légende, des maisons de militants bref, des morceaux d’Amérique que l’administration Trump voulait oublier.
Une philanthropie sans fard
C’est le second gros don versé à cette structure après 20 millions déjà en 2021. Dans un contexte où certains pans de la sphère éducative et culturelle américaine sont assiégés par des discours réactionnaires, voire hostiles, à tout ce qui ressemble à une valorisation des « minorités » ou des récits minoritaires, ce geste prend des allures de riposte symbolique.
MacKenzie Scott, n’est pas une mécène comme les autres. C’est l’anti-Bezos. Mariée au fondateur d’Amazon, pendant vingt-cinq ans, elle a récupéré 4 % des actions d’Amazon, suite à leur divorce en 2019, soit un quart des parts que possédaient le couple. Ce qui fascine chez elle, c’est son refus de jouer la star du don. Depuis son divorce, elle a déjà distribué plus de 16 milliards de dollars, sans fondation ni gala ni logo brodé sur les photos. Elle s’est débarrassée de son pactole comme on largue les amarres. Pas de fondation à son nom, pas de selfies avec les bénéficiaires, pas de storytelling larmoyant. Juste des virements directs à des ONG, des universités, des associations de terrain. Un Robin des Bois de la philanthropie 3.0, sans arc ni caritatif showbiz.
Elle verse, elle s’efface, et publie juste un simple billet sur son site, Yield Giving, pour annoncer la nouvelle : « Nous devons préserver la diversité des récits américains. » Point.
Chaque chèque versé, agit comme une onde de choc. En 2021, elle avait déjà donné 20 millions à la même organisation. Depuis, les candidatures affluent : plus de 6 000 demandes de préservation de sites noirs à travers le pays. Avec ce nouveau don, le fonds espère sauver des centaines de lieux menacés des écoles rurales de Caroline du Sud aux maisons d’artistes de Detroit.
Pourquoi c’est significatif ?
D’abord, parce que 40 millions de dollars ne tombent pas tous les jours dans l’escarcelle de la mémoire noire. Cela témoigne que certains acteurs privés jugent que l’État ou les structures publiques ne suffisent plus. Le AACHAF parle de centaines de demandes, de projets en cours, mais revient sans cesse aux moyens nécessaires : “nous avons un besoin impérieux de ressources pour soutenir la préservation et les communautés à travers le pays”.
Message reçu cinq sur cinq. Le don MacKenzie Scott, tombe à un moment où la mémoire noire est menacée par les bulldozers, les spéculateurs et les politiques d’oubli. Préserver ces briques, c’est empêcher l’effacement. Ce fonds, créé en 2017, a déjà restauré plus de 200 sites historiques : la maison de Frederick Douglass, des églises baptistes qui abritaient les premiers meetings du mouvement des droits civiques, des cimetières de soldats noirs oubliés.
Ensuite, parce que ce type d’engagement symbolise un soutien à « ceux qu’on n’entend pas assez », ou qu’on entend mal. Patrimoine, mémoire, lieux de vie : ce n’est pas juste un don à un hôpital, c’est un investissement dans l’« être là ».
Ce n’est pas que du ravalement de façade. Préserver ces lieux, c’est maintenir debout la cartographie d’une lutte. C’est rappeler que l’histoire afro-américaine ne se résume pas à quelques pages dans un manuel d’école. Elle s’écrit dans le bois, la pierre, la poussière des porches et la mémoire des briques.
C’est aussi un pied de nez à Donald Trump, qui poursuit sa croisade contre les universités jugées trop « idéologisées ». Le président en exercice menace de couper les vivres aux campus qui s’obstinent à enseigner la diversité, le genre, ou l’histoire coloniale sans « patriotisme ». Dans la bouche du président américain, l’université n’est plus un sanctuaire du savoir, mais un repaire de gauchistes.
En mars, il a déjà sabré 400 millions de dollars de subventions fédérales à Columbia, accusée de « laxisme pro-Palestine ». Harvard et Brown sont sur la sellette, et dans son jargon d’homme en guerre, le savoir critique est devenu un virus woke à éradiquer.
Résultat : pendant que l’État se retire de la mémoire, les milliardaires progressistes la rachètent. Le paradoxe américain dans toute sa splendeur : la gauche culturelle qui survit grâce au capitalisme qu’elle déteste. Mais derrière la belle histoire se cache une faille : si la mémoire ne survit que par la charité des riches, que devient la responsabilité publique ?
MacKenzie Scott écrit l’histoire à coups de virements, un roman social à l’américaine comme on les aime. Là où Bezos livre des colis, elle livre du sens. Là où Trump coupe les bourses, elle paie les murs. On peut y voir du cynisme, la milliardaire qui se rachète une conscience sur le dos des injustices qu’a nourries le capitalisme d’Amazon. Ou bien, plus simplement, le geste lucide d’une femme qui connaît le système de l’intérieur et décide de le court-circuiter. Sa fortune est née d’une entreprise qui broie les travailleurs ; elle la réinjecte dans des mémoires qu’on broie depuis des siècles. Mais la vérité, c’est qu’on ne répare pas un pays avec des dons, fussent-ils spectaculaires. On le répare avec de la politique, de l’éducation, et une mémoire partagée.
En attendant, les pierres des églises noires tiendront peut-être debout grâce à une romancière milliardaire.
Et ça, quelque part, c’est déjà une drôle d’histoire américaine.
Sources :