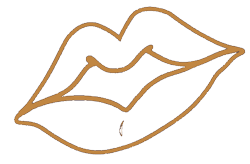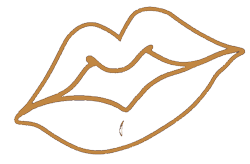Au Théâtre Marigny, jusqu’au 23 décembre, les lundis et mardis soirs, les mots frappent, vibrent, saignent parfois. Sur scène, trois femmes. Trois corps. Trois voix qui disent le sexe, la honte, la joie, le viol, la naissance, l’absence, le plaisir. Les Monologues du Vagin n’ont pas pris une ride, juste des rides plus profondes, celles de notre époque.
Aurore Auteuil, silhouette lumineuse et rage contenue, reprend le texte d’Eve Ensler avec la conviction tranquille de celles qui savent que parler du corps des femmes reste un acte politique. « Le monde, dit-elle, reste sourd et mutique à ce sujet incandescent. »

Quand « vagin » rime encore avec tabou
Mardi soir, 2 décembre, 20 heures. Le Studio Marigny se remplit doucement d’une foule presque uniquement féminine. Des femmes de tous âges : cheveux argentés, jeunes mères pressées, étudiantes en Doc Martens, quadras affûtées, retraitées élégantes, bande de copines, solitaires déterminées. Quelques hommes, aussi, mais d’un certain âge, cheveux poivre et sel, lunettes fines, l’allure de ceux qui lisent Télérama debout au kiosque.
Et puis il y a ceux qui ne sont pas là. Les jeunes hommes. Les vingtenaires, les trentenaires. Ceux qui auraient le plus à entendre, à apprendre, à désapprendre. On aurait voulu les voir, eux, assis dans la salle, un peu gênés, un peu curieux, un peu bousculés. On aurait voulu les voir se sentir concernés, secoués, débarrassés de cette masculinité toxique qui flotte encore dans l’air du temps comme un vieux parfum de virilité périmée. À la place, ce sont surtout les femmes qui viennent écouter parler de leur propre corps.
Encore. Toujours. Comme si ce combat-là devait encore être mené entre elles, pour elles, sans eux. Le théâtre s’assombrit, le rideau frémit. Et la soirée peut commencer.
En venant ce soir-là au Studio Marigny, accompagnée de mon amie Anaïs, je m’attendais à voir et écouter une pièce “engagée”, un peu documentaire, voire militante. Mais je n’imaginais pas qu’au cœur d’un texte vieux de près de trente ans, le classique d’Eve Ensler, qu’on puisse encore rire, tanguer, glousser, avant de tomber d’un coup dans le fond du gouffre. Pourtant, c’est bien ce que réussit Aurore Auteuil avec une mise en scène qui ose l’inconfort, le dérangement, pour réveiller un tabou que l’on croyait anesthésié.
Le rideau s’ouvre sur un French cancan, Anaïs se tourne vers moi sourire aux lèvres, elle adore Offenbach. Mais, Les Monologues du Vagin version Aurore Auteuil ne sont pas un divertissement, loin de là. Ce sont des coups. Des vrais. Des qui résonnent longtemps. Autour d’elle, deux présences fortes : Galia Salimo, pionnière trans et reine des nuits parisiennes, et Camille Léon-Fucien, tout sourire, sortie du Conservatoire, et regard brûlant de sincérité. Trois générations, trois trajectoires, mais une même langue : celle de la résistance, du mot qui caresse autant qu’il bouscule.
Ce qui fonctionne : le fracas émotionnel, le mélange déroutant
Je ne m’attendais pas non plus à tomber sur « Gangsta’s Paradise » du rappeur Coolio, ça me rappelle des souvenirs. Puis c’est un défilé de prénoms masculins. Aurore, Camille, et Galia évoquent ces hommes qui traversent les corps des femmes comme on traverse une chambre d’hôtel : furtifs, maladroits, persuadés d’être inoubliables. Michel, Andy. Des amants de passage, des médiocres égarés, des inoffensifs catastrophiques. Galia Salimo raconte Andy, ah, Andy celui qui n’avait pas compris qu’elle était une femme fontaine. Le public éclate de rire. Un rire franc, libérateur, un rire qui dit : « On en a toutes connu un, des Andy. » Et puis très vite, le ton glisse. La drôlerie déraille. La parole se densifie. Ce qui n’était qu’un inventaire cocasse des catastrophes masculines se fissure. Derrière les prénoms, il y a les blessures. Derrière les maladresses, il y a l’emprise. Derrière Andy, Michel, les autres, il y a l’ombre du patriarcat, massif comme un décor qu’on traîne depuis trente siècles.
On rigole de Miche qui admire le vagin de Aurore pendant un heure, qui “la regarde vraiment”. On se détend. On se croit en terrain léger. Et puis la pièce glisse, subrepticement, vers l’horreur du quotidien, viol, agression, pédophilie, honte, soumission. Le contraste est violent, efficace. Quand Aurore Auteuil parle avec sa voix de petite fille, de viol, de l’enfance, de la violence vécue, la confession est troublante, vraie.
Elle raconte ce viol, chez le père lors d’une fête. La fillette a quelques années. L’agresseur qui la pénètre violemment, est un ami de la famille. Le silence du public tombe comme du plomb fondu. Puis elle lâche cette phrase, presque en apnée : « Mon père a tiré. Il a fini paralysé. Du sang, du sang partout, sur mon vagin…». Un viol, un fusil, et l’enfance volée.
Personne ne respire. On se demande si c’est du théâtre ou de la mémoire. Elle ne tranche pas. Un autre épisode. À 16 ans, une femme, belle, pédophile, l’embarque en voiture, l’embrasse, demande à sa mère si elle peut la “ramener chez elle”. La mère ne se méfie pas. Moment gênant, presque irréel, où le public s’agite sur son siège. Les abus ont des visages qu’on ne veut jamais nommer. Elle, si.
Pendant la confession, Auteuil ne joue pas, elle exorcise. Et elle le fait en refusant la posture victimaire, avec un ton sec. Il n’y a pas de larmes, mais de l’humour, comme une nécessité. A aucun moment elle ne décrit cette agression comme un autre viol. Est-ce parce que le monstre est une femme, et qu’elle l’éveille à la sensualité, au plaisir, et lui fait douter de sa sexualité ? Le public est pétrifié, mais c’est là que le spectacle prend toute sa puissance, dans cette collision entre le rire et l’effroi, entre l’anecdote sexuelle et le crime silencieux, entre la légèreté du début et la gravité de ce qui suit.
Et puis une pensée me traverse, sournoise, involontaire : Daniel est-il venu voir sa fille dans ce rôle-là ?
Voir Aurore cracher la vérité, raconter l’indicible, déplier les traumas, les tabous, les blessures anciennes comme on retourne une terre que personne n’avait osé toucher ? Est-ce qu’un père, ce père-là, figure publique, monument du cinéma français, peut entendre sa fille dire sur scène ce que tant de familles préfèrent enterrer ? Est-ce qu’il peut recevoir ce monologue comme un acte artistique, ou bien comme une déflagration intime ? On ne le saura pas.
Arrive Galia Salimo, avec sa voix rauque mais habitée. Elle évoque la transidentité, l’excision, les corps mutilés, la douleur transmise et subie, elle sait de quoi elle parle. Dans le contexte actuel de débats stériles sur le genre, la masculinité, la place des corps trans, sa voix sur scène fait écho à tout ce qui a été tu, effacé, nié. La salle rit quand elle parle de son vagin comme un poisson, qu’elle habille parfois en chanel. Galia Salimo magnifique, charismatique. Elle a traversé les clubs, les regards, les insultes, les nuits parisiennes et les clichés. Elle connait mieux que personne la douleur de la transition, les années où elle devait “se débattre avec un corps qui n’était pas le sien”. Sa voix tremble mais ne rompt pas. Galia sait raconter la violence avec un humour de survivante. C’est rare, et précieux.
Et puis, il y a Camille la plus jeune qui raconte la vie secrète, parfois volée de son vagin. Et le fantasme de ce mari pour les vagin épilés de près. « Mon mari me force à me raser. Ça me brûle. Ça frotte. Ça saigne.» Comme si les femmes devaient être lisses pour exister. Une autre histoire, celle où elle délaisse la profession d’avocate pour devenir une maitresse SM qui donne du plaisir à d’autres femmes. La salle rigole, puis se crispe. L’humour, chez Camille, sert de scalpel. Parce qu’on rit souvent, tout au long de la pièce, justement pour ne pas serrer les dents.
On comprend mieux pourquoi Les Monologues du Vagin, dans cette version 2025, ne sont plus seulement une pièce féministe, mais un lieu où les corps disent enfin tout ce qu’on leur a fait. On ressort, avec la sensation étrange d’avoir assisté à quelque chose de vivant, de mouvant, de dangereux. Camille Léon-Fucien livre une performance précise, nerveuse, immédiatement contemporaine : elle parle comme on vit aujourd’hui, rapide, drôle, lucide. Galia Salimo, elle, donne au plateau une profondeur historique, une mémoire queer et trans qui manque cruellement au théâtre français, une présence qui bouleverse sans jamais quémander l’émotion. Et Aurore Auteuil, avec sa retenue douloureuse, cette façon de laisser certaines phrases tomber comme des pierres, offre à la pièce un centre de gravité moral.
Alors oui, la mise en scène pourrait être, plus “théâtre”. Oui, le texte est parfois lu, parfois incarné. Mais c’est justement dans ces dissonances qu’elle trouve sa force. Le spectacle réussit surtout ce que très peu de pièces féministes parviennent à faire : tenir ensemble le rire, la honte, le sexe, le trauma, et le plaisir. Parce qu’il y a des vérités qui ne sont pas seulement jouées.
Plus d’infos:
Les Monologues du vagin, au Studio Marigny (Paris 8e), le lundi et le mardi jusqu’au 23 décembre. www.theatremarigny.fr