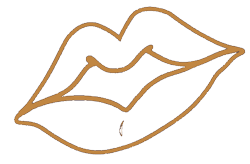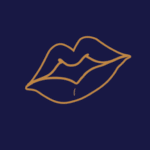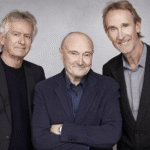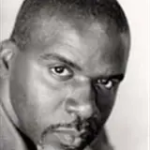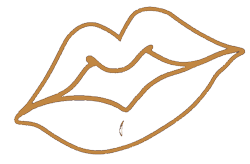On savait que le cinéma d’animation pouvait ressusciter des fantômes, Walt Disney l’a fait avec les contes, Miyazaki avec les esprits des forêts, mais Sylvain Chomet le poète des Triplettes de Belleville, ose un pari audacieux : redonner vie à Marcel Pagnol, non pas en biopic figé, mais en aventure intérieure animée. Dans Marcel et Monsieur Pagnol, l’auteur de La Gloire de mon père se dédouble : l’homme accompli croise le petit garçon qu’il fut, dans une Provence revisitée, presque hallucinée. Et quand SCH met du beat dans la garrigue, la Provence a du flow, la mémoire est samplée. Pagnol remixé, cigales autotunées, une version dessin animé hardcore sentimental.
L’envie de raconter (et de réinventer)
Sylvain Chomet n’a pas choisit la simple reconstitution : il fait dialoguer le Pagnol adulte et le Pagnol enfant. Le petit garçon qui rêvait, piaffait, écoutait les cigales et l’homme déjà célèbre, façonnant son œuvre, ses paradoxes. L’un dessine son futur, l’autre regrette son enfance. Les couleurs, entre sépia et mirage, rappellent que les souvenirs sont faits de couches superposées, comme un vieux cellulo peint à la main.
Ici, l’animation est un langage mental, un jardin secret où l’imaginaire et le souvenir se répondent. Quant aux plans, ils oscillent entre paysages provençaux stylisés, collines, oliviers, ciel lourd, et intérieurs de papier, assemblages de décors qui rappellent les décors de théâtre miniature. Le procédé visuel, parfois tactile, rappelle que les souvenirs ne sont pas des films, ils sont des toiles froissées, des relectures. Chomet joue sans naufrage, mais pas sans audace : les transitions sont des petits cauchemars, les silences plus parlants que les dialogues, les voix intérieures insistantes.
SCH fait danser les cigales
Mais la vraie surprise, c’est la bande-son signée SCH. Oui, le rappeur de Marseille. Celui des flow rocailleux et des refrains crânes, convoqué ici pour faire groover les cigales. Et contre toute attente, ça marche : les beats lourds épousent la douceur provençale, les basses font vibrer les collines d’Aubagne. SCH ne trahit pas Pagnol, il le dépoussière à coups de samples et de silence. Le passé prend du BPM, le terroir du flow.
Un Lafitte muet mais éloquent
Laurent Lafitte prête sa voix à Pagnol adulte, avec sobriété, laissant souvent l’image porter le poids de l’enfance. Le contraste est heureux : ses interventions vocales surprennent moins que les silences animés, les champs vides où flotte l’ombre d’un cri ou d’une nostalgie. Il n’essaie pas de « doubler » Pagnol, mais de le suggérer : l’enfant-Pagnol n’a pas de voix, ou plutôt, sa voix demeure dans l’image et dans le mouvement du dessin. Lafitte, prudent, ne surcharge pas ; il murmure, il incline, il retient. Les mots tombent, les silences respirent, et dans les interstices, SCH injecte son tempo, discret mais vital.
Entre respect et rébellion
Chomet évite le piège du monument. Il ne sanctifie pas Pagnol, il le questionne. L’homme qui inventa le cinéma parlant devient ici un personnage muet, enfermé dans son propre récit. Et c’est le dessin qui parle à sa place : fluide, vibrant, fragile.
Certaines séquences s’égarent dans le maniérisme, mais l’ensemble dégage une sincérité rare. On sent Chomet ému par le vieil auteur, SCH fasciné par l’enfant qu’il fut, et nous, un peu bouleversés par cette rencontre improbable entre la Provence des années 30 et le rap de 2025.
Le pari de mettre le dessin au service de la mémoire est vertigineux. Mais Marcel et Monsieur Pagnol ose (et parfois bute), tout en essayant d’atteindre ce lieu où le mot « souvenir » heurte la matière du dessin.
Le film ne tient pas toujours ses promesses, mais il les porte. Et, dans cet automne cinématographique, il invite à une promesse modeste, celle de ressentir, à nouveau, le murmure d’un enfant qui écoute les cigales, un homme qui regrette le chant, et peut-être, enfin, une voix qui accepte le doute.
Pagnol aurait sans doute levé son verre : « Enfin, quelqu’un m’a compris, et remixé. »