Au Japon, un phénomène préoccupant est en train d’être documenté : celui des « bousculades volontaires » (en japonais « butsukari‑otoko », littéralement « l’homme qui se cogne »), des hommes qui, dans des lieux publics surpeuplés, heurtent intentionnellement des femmes (ou parfois des hommes qu’ils jugent vulnérables) sous couvert de la foule.
Tokyo, Shibuya, heure de pointe. Des milliers de corps s’entrechoquent, se frôlent, se pressent. Et parmi eux, certains hommes décident de ne plus seulement marcher, mais de cogner. Butsukari-otoko, c’est leur surnom : les “hommes qui bousculent”. Pas par maladresse, non. Par frustration, par rancune, par rage contenue. Une violence discrète, dissimulée dans le flux des passants, comme une gifle donnée en douce, à toutes les femmes qui osent exister dans la foule.
La rue champ de bataille invisible
Le Japon, a la réputation d’être une société policée, ultra-codée, aux gestes millimétrés. Pourtant, le pays découvre soudain sa zone d’ombre : celle de ses trottoirs. Ce n’est pas un féminicide, ni une agression sexuelle au sens strict, mais une micro-violence, répétée, banale, presque invisible. Et c’est précisément ça, le problème.
The Japan Times, Asahi Shimbun, Tokyo Weekender évoquent ces hommes d’âge moyen qui foncent dans les femmes comme pour “reprendre du terrain”. Une forme de revanche physique, mesquine, sur un monde où ils se sentent relégués. Des gestes minuscules, mais saturés de symboles, parce qu’ici, tout est dans le geste.
D’autres médias japonais et anglo-saxons ont relayé des cas où, dans des gares, ou à des moments de forte affluence, des individus se déplacent à l’intérieur de la foule en visant des femmes, et provoquent des collisions ou des bousculades « accidentelles ». Dans l’enquête citée par The Japan Times, les « butsukari otoko » (ou « butsukari ojisan » pour la tranche d’âge plus âgée) sont repérés dans les stations de métro ou de train où les flux sont denses. « Perpétrateurs » comme les nomment, les médias nippons, sont souvent des hommes d’âge moyen (« middle-aged men ») qui ciblent des femmes d’apparence plus frêle ou « non conflictuelle ». Un article du South China Morning Post mentionne que ce type d’agression a même été observé hors du Japon, à Londres, mais initialement relève d’un comportement urbain japonais.
Par ailleurs, sur le sujet du harcèlement par contact direct dans les transports, une enquête réalisée à Tokyo révèle que « 56,3 % des femmes et 15,2 % des hommes ont été victimes de « chikan » (attouchements) dans les trains ou gares ». Le terme « chikan » désigne les attouchements sexuels non désirés dans des espaces publics, en particulier dans des transports surpeuplés.
Enfin, pour tenter de contrer ces agressions, certaines compagnies de transport japonaises ont mis en place des voitures exclusivement réservées aux femmes (women-only cars). Une enquête de 2018 indiquait que près de 70 % des femmes à Tokyo approuvaient cette mesure.
Ironie du calendrier, c’est au moment où le Japon se dote pour la première fois d’une femme à sa tête, Sanae Takaichi, le pays voit (re)surgir cette vague de violence passive. Un frémissement machiste, presque désespéré, comme si l’ego masculin collectif se cabrait à la moindre avancée féminine. Le plafond de verre est fissuré, alors certains de ces hommes frustrés cognent les murs.
Sanae Takaichi a été élue cheffe du gouvernement et est la première femme Premier ministre du pays.
Cette avancée symbolique est intéressante dans un contexte de harcèlement de rue et de violences de genre. Les observateurs espéraient que ce changement de politique se traduise dans la société civile, toutefois, certains soulignent que, malgré cette nomination, l’équilibre homme‐femme dans les postes politiques reste fortement déséquilibré.
Et la France dans tout ça ?
En France, le scénario n’est pas si différent. Ce ne sont pas des “bousculades volontaires”, mais des sifflements, des “t’as un 06 ?”, des “fais pas la belle”, des mains baladeuses dans le métro. Ici aussi, les femmes serrent les poings dans leurs poches, calculent leurs itinéraires, rentrent plus tôt, plus vite, plus seules.
Le harcèlement de rue est aussi un problème documenté : sifflements, injures, propos sexués, attouchements, bousculades volontaires sont des comportements signalés par de nombreuses femmes dans les espaces publics. L’insécurité, l’agacement, la peur de marcher seule le soir ou d’emprunter certains trajets, sont le lot quotidien de plusieurs femmes.
Même si les modalités peuvent différer (le contexte urbain, la densité, les transports, la culture locale), le parallèle existe : il s’agit toujours d’un rapport de genre, de vulnérabilité, d’occupation de l’espace public par les femmes.
Une étude IFOP pour la Fondation Jean‑Jaurès et la Fondation européenne d’études progressistes indique que 86 % des femmes en France déclarent avoir déjà été victimes d’au moins une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue (du regard au viol).
Parmi elles : 66 % ont essuyé des sifflets au cours de leur vie (11 % dans les 12 mois).
43 % disent avoir déjà été suivies sur une partie de leur trajet (5 % dans l’année)
31 % ont subi des attouchements (3 % dans l’année)
Selon les données du Ministère de l’Intérieur françaises pour 2024 : 3 200 infractions d’« outrage sexiste ou sexuel » ont été enregistrées, soit une baisse de 5 % par rapport à 2023.
74 % des infractions ne comportent pas de circonstance aggravante.
26 % sont des délits avec circonstance aggravante.
89 % des victimes sont des femmes.
Environ 97 % des mis en cause sont des hommes.
15 % des outrages sexistes enregistrés ont lieu dans les transports en commun.
Autre repère : En 2018, on recensait 81 % des femmes déclarant déjà avoir subi une forme de harcèlement sexuel dans l’espace public (rue ou transports).
Ces chiffres montrent qu’en France, le harcèlement de rue est majoritairement vécu par les femmes, jeune public particulièrement exposé, et qu’il a une forte dimension urbaine (grandes villes, transports). Moralité, l’espace public n’appartient toujours pas à celles qui le traversent.
Le Japon a mis en place des wagons réservés aux femmes, une mesure que certains trouvent “curieuse” en Europe, sauf peut-être celles qui montent dans un RER bondé un vendredi soir. Dans les deux cas, les corps féminins deviennent une variable d’ajustement de la frustration masculine.
Plus précisément, le phénomène japonais des « bousculades volontaires » (butsukari otoko) a une dimension « mascarade de la foule » qui peut sembler plus spécifique au Japon urbain (gares surpeuplées, etc.). En France, on parle plus souvent de harcèlement verbal, d’agressions par attouchements ou propos, ou de harcèlement visuel. Mais la logique est comparable : des hommes utilisent la foule ou la proximité pour imposer un sentiment de menace, d’insécurité, de domination.
Dans les deux pays, ce sont majoritairement les femmes qui sont ciblées dans l’espace public. Le fait que ce soit dans les espaces de circulation (rues, gares, transports) renvoie à une question d’accès à la ville, à la mobilité en tant que femme : la peur limite les libertés. Le rôle de la culture de l’impunité ou de la banalisation de ces gestes : que ce soit bousculer «par hasard» ou «on ne l’a pas vu venir», la victime reste souvent seule.
Au Japon le phénomène «butsukari otoko» est plus clairement décrit comme une pratique ciblée, systématique, et il existe des statistiques spécifiques et des formes institutionnalisées de réponse (voitures réservées aux femmes, campagnes d’affichage) ; en France, si l’on a des données globales sur le harcèlement de rue, on a moins de catégorisation «bousculade volontaire dans la foule» dans le débat public.
Le système des transports japonais, la densité dans les gares et la culture collective de la foule, donnent à ce type de harcèlement des conditions particulières (ex : la légitimité de «je me suis fait bousculer dans la foule» rend plus difficile l’identification comme acte volontaire). En France, la dimension verbale et visuelle du harcèlement est peut-être plus fréquemment évoquée que la bousculade physique dans la foule, même si elle existe.
Ce parallèle entre les deux pays importe, parce qu’il permet de comprendre que l’espace public n’est pas neutre, et que les modalités de harcèlement varient selon les contextes culturels et urbains, mais que le problème global reste celui de l’égalité dans la mobilité, de la liberté de circuler, et du droit à ne pas être harcelée.
Le fait que le Japon, qui a désormais une femme à sa tête, soit confronté à ce type de comportements, invite à réfléchir : une femme à la tête de l’État ne suffit pas à transformer automatiquement la culture de harcèlement. De même en France, avoir des lois et des campagnes ne veut pas dire que les pratiques disparaissent.
Le phénomène des « bousculades volontaires » au Japon rappelle que le harcèlement de rue prend des formes variées, que le contexte urbain et culturel compte, mais que, fondamentalement, il s’agit d’un rapport de genre et d’un obstacle à l’égalité. En France, le harcèlement de rue rejoint ce constat, avec ses propres modalités. L’enjeu est de regarder les similitudes pour enrichir le débat, mais aussi les différences pour adapter les stratégies de lutte et de prévention : mobilisation citoyenne, témoins actifs, signalement, changements urbains (éclairage, supervision, transports), éducation à l’égalité dès la jeunesse.
Sources :
Enquête du Tokyo Metropolitan Government (2024) montre que 56,3 % des femmes et 15,2 % des hommes à Tokyo ont été victimes de « chikan » (attouchements dans les trains ou gares).
Dans la même étude, sur l’année écoulée : 18,2 % des femmes et 7,9 % des hommes avaient subi un «chikan».
Concernant spécifiquement les butsukari otoko : On décrit des « hommes d’âge moyen » qui ciblent « des femmes d’apparence plus frêle ou non conflictuelle » dans des lieux surpeuplés pour bousculer volontairemen
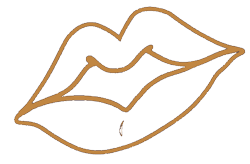

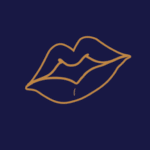





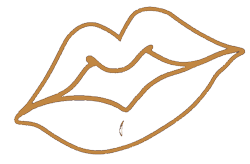
ce genre de comportement je le vis au quotidien tous les jours dans l’espace public à Paris,mais personne n’en parle!
c’est le tous contre tous, jeunes, vieux, toutes catégories sociales confondues…les micro violences mesquines quasi invisibles toujours calculées: on ne devie pas sa trajectoire pour laisser l’autre passer en comptant que l’autre (toi) se pousse pour eux, et ils donnent un coup d’épaule en faisant comme si de rien n’était, il y a aussi les escadrons en lignes occupant toute la largeur des trottoirs même très larges sans laisser un espace pour que ceux qui arrivent en face ou derrière eux puissent passer sans les gener, ceux qui s’adossent dur les autres (plutôt sur des femmes) de tout leur poids dans le métro en espérant récupérer leur place en les faisant fuir ou leur foutant brutalement un énorme baffe car tu leur demande d’arrêter (je l’ai vécu ! personne n’a bougé, on m’a dévisagée comme si le fait de demander sèchement qu’il arrête était une faute justifiant la baffe…), etc, etc, etc…..ça fait 15 ans que ça monte, et que ces choses parfois nommées “incivilités” mais qui sont des atteintes physiques (coups depaules, baffes…) et génèrent un stress chronique quand on n’a pas cet état d’esprit pervers (ils générent la peur).
cela découle selon moi d’un défaut d’éducation avec les parents copains, souvent divorcés à la botte de leurs rejetons ensevelis sous les biens matériels pour se dédouaner de ne pas passer de temps avec eux et acheter leur tranquillité pour éviter le difficile travail d’éducation incluant des valeurs sociales comme le respect des autres et de soi, l’attention de ne pas tout prendre pour soi, faire attention à ne pas faire de mal aux autres verbalement et physiquement, à être civique dans l’espace public qui n’est pas leur espace privé et doit être partagé équitablement et prioriser les personnes plus âgées ou chargées ou en difficulté….c’est un choix d’éducation et de vie en société non violente.
Ceux qui tolèrent autre chose ouvrent la porte à la violence ordinaire qui nie l’autre voire l’objective (le rend object), c’est l’ouverture à l’inhumanité, qui mène aux guerres et peut justifier toute forme de massacre sur la durée. Ça fait monter la haine, ou l’indifférence à l’autre et à son ressenti, la séparation et l’isolement égocentrique ou désespéré, la,peur et le violence gratuite tolérée car non verbalisée clairement. L’école a été empêchée par clientellisme d’enseigner comme avant l’éducation civique, le respect de l’autre…elle est maintenant le terrain et le terreau du harcèlement psychologique laissé là encore en roue libre, sans sanction ni limitation…la boucle est bouclée.