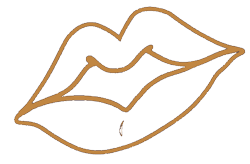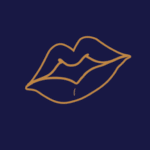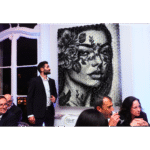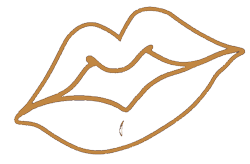Notaire en région parisienne, Fabian Regairaz signe Ma maison chez les ploucs, roman grinçant sur le déracinement, la honte sociale et les retours forcés vers ce qu’on croyait avoir enterré. Un immeuble téléporté de Vincennes à Saint-Étienne, un héros snob, une tumeur possible et la province comme miroir déformant : derrière la farce se cache un règlement de comptes intime. Conversation sans code civil.

Rapporteuses : Dans le roman, un immeuble entier est téléporté à Saint-Étienne. Vous aussi, vous aviez besoin d’un tremblement de terre pour retourner à vos origines ?
Fabian Regairaz : Rires. Excellente question ! Oui, sans doute. J’ai longtemps cherché pourquoi ce retour prenait chez moi une forme aussi spectaculaire, et je crois que c’est parce que je l’ai vécu comme ça enfant. Nous vivions à Lyon, près de mes grands-parents, et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés à Saint-Étienne. Jusque-là, rien de dramatique. Mais ma mère, assez snob, il faut bien le dire, me répétait, mi-plaisantant mi-sérieuse, de ne surtout pas attraper l’accent stéphanois : en gros, d’y vivre sans en être. Et ma grand-mère paternelle, originaire de Chatou, près de Paris, nous appelait « les ploucs » quand on rentrait du déjeuner familial, avec notre grosse plaque « 42 » sur les fesses.
Alors oui, j’ai sans doute recréé le choc que j’ai ressenti enfant. Bon, après, tout ça reste très relatif : on vivait quand même dans un appartement haussmannien de 400 m², loué douze roubles par an.
Rapporteuses : Votre héros est notaire, coincé, snob, un peu lâche. Jusqu’où est-il votre autoportrait ?
F.R. : Vous êtes plutôt directes chez Rapporteuses ! Je voulais surtout un narrateur empêché, et ça, oui, c’est assez autobiographique. Il est sous la férule de son beau-père, un promoteur immobilier tyrannique qui lui a longtemps permis de se la couler douce en lui apportant de gros clients. Catapultés à Saint-Étienne, le promoteur perd son entregent, et le notaire doit, pour la première fois, trouver ses propres dossiers.
Je voulais montrer l’image trompeuse du notaire croulant sous les clients, alors qu’en réalité c’est un chef d’entreprise comme un autre, obligé de se battre pour faire tourner la boutique.
Et pour la proverbiale lâcheté masculine… disons que je vous laisse la paternité, ou plutôt la maternité, de la question. C’est du woman-splaining, non ?
Rapporteuses : Saint-Étienne, dans votre livre, c’est presque le purgatoire. Vous n’avez jamais eu peur qu’on vous accuse de cracher dans la soupe ?
F.R. : Oh non, pas du tout ! Déjà, je n’ai jamais travaillé à Saint-Étienne, je faisais la route jusqu’à Lyon tous les jours. Et puis, entre nous, c’est une ville où il faut être né pour y bosser… Je plaisante, hein, ne le marquez pas ! (Rires.)
Disons que j’entretiens un rapport un peu schizophrène avec cette ville : elle m’émeut autant qu’elle m’exaspère. Elle possède un centre-ville charmant, des infrastructures correctes, elle est proche de Lyon, de la moyenne montagne et d’une base de loisirs où l’on peut se baigner ou faire du ski nautique. La ville devrait davantage communiquer là-dessus : même dans le Perche, où l’ennui frôle l’angoisse, ils y parviennent !
Ce qui la condamne, c’est l’enclavement. Si elle était à vingt minutes de Lyon, ce serait un petit Brooklyn vert. Mais le projet a été enterré, parce qu’il passait trop près des villas des notables locaux. Voilà, c’est très français, tout ça.
Rapporteuses : Vous écrivez sur la honte sociale. C’est quoi la vôtre : être monté, ou être parti ?
F.R. : Je suis issu, pour le dire vite, de la petite-moyenne bourgeoisie : petit-fils de dentiste, petit-fils de chef d’entreprise, fils de médecins… bref, j’ai scrupuleusement respecté ma caste en devenant notaire.
Mes parents appartenaient à ce que j’appelle, enfin, personne ne dit ça, mais moi oui, la bourgeoisie clinquante : Club Med, rideaux perroquets, Port-Grimaud, Val d’Isère, polos Daniel Hechter… Vous voyez le tableau.
En venant de cette ambiance carrée fluos et rires sonores, j’ai eu honte, plus jeune, face à la bourgeoisie plus ancienne, plus feutrée, plus tamisée. J’avais l’impression qu’on débarquait comme des singes hurleurs dans une bibliothèque. Et cette honte, je crois qu’ils me l’ont transmise.
Mon père arrivait de Chatou, pas du bon côté de la bourgeoisie lyonnaise, et ma mère d’Alger, ce qui, à Lyon, revenait à entrer en dromadaire dans un
Fabian Regairaz
salon Louis XV.
Rapporteuses : Au fond, le livre pose une question très française : peut-on vraiment changer de classe sociale, ou est-ce qu’on reste toujours “le petit de quelqu’un” ?
F.R. : C’est vrai que cette question se pose moins aux États-Unis, où l’on est ce que l’on fait. En France, qu’on en soit conscient ou non, on trimballe nos ancêtres avec nous, ce qui est assez logique, puisqu’on n’a pas bougé. C’est comme toutes les communautés : une force, et un boulet terrible. Il faut apprendre à composer avec les deux bouts de la corde. Et puis, un peu comme les autodidactes, il reste toujours un petit complexe lorsqu’on s’élève socialement. Mais disons qu’on le vit mieux au fond d’un jacuzzi.
Rapporteuses : Votre humour est noir, acide, parfois cruel. Vous vous méfiez des bons sentiments ?
F.R. : Au contraire, j’adore les bons sentiments ! Les Jean Valjean, les Jules Vallès, les héros univoques, entièrement tournés vers le Juste et le Bon. On a besoin de ces figures structurantes, surtout quand on est jeune. Mais j’ai grandi dans un milieu très railleur, très moqueur : on regardait les comédies du Splendid, et mes parents n’étaient pas les derniers à tenter de nous humilier, gentiment, hein, mais il fallait se défendre ! Alors j’ai sans doute développé un humour un peu grinçant, une manière de mettre les choses à distance.
Fabian Regairaz
J’ai le portable de Freud, on peut toujours lui demander ce qu’il en pense.
Rapporteuses : Votre héros découvre que l’absurde, c’est le réel. Vous, comme notaire, vous voyez passer plus de tragédies ou plus de comédies ?
F.R. : C’est ce que je dis à un moment dans le livre : d’accord, ils ont été catapultés dans une autre ville en dépit du bon sens… mais pendant qu’on s’interroge là-dessus, on dérive quand même dans l’espace, à une vitesse folle, sur une boule bleue sortie d’on ne sait pas où ! Dans mon métier, je vois surtout des comédies humaines. Les ventes immobilières, c’est souvent un moment heureux : les gens concrétisent un projet, reçoivent leurs clefs, c’est une étape symbolique. Nous sommes le passage obligé, mais aussi la dernière porte avant la joie.
Après, il y a bien sûr les querelles familiales, les règlements de comptes, ceux qui profitent du dossier pour “se faire entendre”, parfois contre leurs propres intérêts. Mais l’argent, n’est-ce pas, c’est toujours de l’affect.
Rapporteuses : Il y a cette phrase dans le roman : “On ne déchire pas l’ombre de son passé.” Vous avez essayé, vous ?
F.R. : Comme tout le monde, j’ai voulu “refaire le match”. J’ai eu un divorce compliqué, et forcément, on se dit qu’on ne referait pas tout pareil si on revenait vingt-cinq ans en arrière. Sinon, on serait un bélier mérinos ! Le problème avec le passé, c’est qu’on le juge avec la personnalité qu’on a aujourd’hui. On oublie qui on était, ce qu’on savait, ou ce qu’on ne savait pas. Alors forcément, on a honte, on se dit qu’on a été idiot, qu’on n’aurait pas dû réagir comme ça. Mais il faut bien admettre qu’on fait avec les moyens du bord au moment où les choses nous tombent dessus. Comme disait Lénine : “Il faut travailler avec le matériel existant.”
Rapporteuses : On parle beaucoup de “Paris vs la province”. Vous pensez vraiment que la fracture territoriale, c’est d’abord une fracture d’ego ?
F.R. : Je croyais cette guéguerre enterrée avec Internet. Et puis, sur les réseaux sociaux, je me rends compte qu’elle fait rage plus que jamais. Je ne sais pas si c’est seulement de l’ego, enfin si, un peu quand même, mais c’est surtout une absence totale de dialogue, de didactique. Ça se résume à : « Paris, vous vivez dans 11 m² à 1 500 euros, je pourrais pas, moi j’ai mes vaches » contre « tes vaches qui puent, moi je pourrais pas, Paris ça vous dépasse ».
Comme toujours, chacun parle tout seul et voit midi à sa porte. La vraie solution ? Un T5 dans le 7ᵉ et une maison de campagne. Là, tout le monde est réconcilié.
Rapporteuses : Si vous aviez un immeuble à déplacer aujourd’hui, vous l’enverriez où ? Et ne me dites pas “loin”.
F.R. : Facile, j’enverrais le quartier d’Aligre et les Batignolles direct à Montceau-les-Mines. Ça les calmerait.
Plus d’infos :