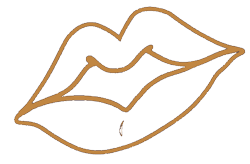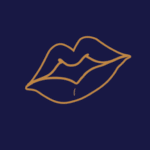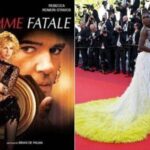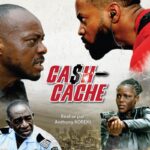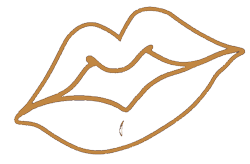À l’heure où les IA et les milliardaires de la Tek rêvent d’immortalité, Guillermo del Toro ressuscite le mythe de Mary Shelley dans Frankenstein (2025) sorti le 7 novembre sur Netflix. Dans cette version baroque et fiévreuse, un monstre cherche l’amour pendant que son créateur s’enivre de lui-même. La science, la mort, et la vanité des hommes, rejouées comme une tragédie amoureuse. Le monstre ne fait plus peur, il fait pleurer. Del Toro signe un requiem amoureux pour l’humanité celle qui veut jouer à Dieu, celle qui échoue à aimer.
Dans une mer de glace, un corps semble appeler à l’aide, des éclats d’électricité découpent la chair, un cri déchire la nuit. Voilà, Frankenstein est né, encore. Mais chez Guillermo del Toro, ce n’est plus une histoire de foudre et de science. C’est une histoire d’amour. D’amour impossible, d’amour fou, d’amour égoïste.
Victor Frankenstein (Oscar Isaac, visage taillé à la serpe) n’est pas un scientifique comme dans les autres versions. C’est un Narcisse sous amphétamines, un homme ivre de son propre génie, persuadé que créer la vie est une forme supérieure d’amour. Face à lui, sa créature (Jacob Elordi, bouleversant) n’est pas le monstre auquel on aurait pu s’attendre, mais un enfant nu dans un monde sans tendresse. Un être qui n’a rien demandé, sinon un peu de regard. Et c’est peut-être ça, la tragédie : l’amour sans miroir, l’amour sans retour.
Le monstre amoureux
Jacob Elordi, immense, visage tendre et couturé, donne à la créature une humanité désarmante. Ce n’est pas un golem, c’est un adolescent blessé. Il marche comme on cherche un sens, parle comme on apprend à respirer. On le dit difforme ? Il ne l’est que dans les yeux d’Elizabeth, ni sous les doigts de son ami aveugle. Del Toro, fidèle à sa tendresse pour les monstres (La Forme de l’eau, Crimson Peak), inverse les rôles : le vrai monstre, c’est le créateur.
La créature, elle, aime. Elle aime d’abord la lumière, puis la voix d’une femme (celle, fantomatique, qui lit Shelley à voix haute), puis la mémoire de son père. Mais chaque amour se brise sur le même écueil : l’impossibilité d’exister pour quelqu’un. Le film prend alors des allures de mélodrame gothique. Le monstre se fait poète. Il cite Shelley sans le savoir, regarde la lune comme un exilé, tend les bras vers un monde qui ne veut pas de lui. Sa quête devient presque mystique : être regardé autrement.
Beauté baroque, tragédie de chair
Del Toro n’a rien perdu de sa folie visuelle. Frankenstein ressemble à un musée de cauchemars : verrières éclatées, cathédrales de verre, viscères baignés de lumière bleue. La caméra glisse, caresse, tremble. Chaque plan est une peinture, chaque ombre une prière. Mais derrière la beauté, il y a le sang. Le cinéaste mexicain filme la matière vivante avec une tendresse morbide : muscles, cicatrices, sutures. Tout respire. Tout souffre.
Ce goût du détail organique, était déjà présent dans Le Labyrinthe de Pan ou Hellboy, mais ici poussé jusqu’à l’intime. La chair devient le lieu du drame. Elle pense, elle se souvient, elle pleure. La créature n’est pas un assemblage de morceaux : c’est un collage d’émotions humaines. Et c’est peut-être la plus belle idée du film : nous sommes tous des fragments cousus d’amour et de douleur.
La scène où le monstre apprend à parler, haletant, balbutiant le mot “père”, reste l’une des plus fortes du film. On n’y voit pas un freak. On y voit un enfant. Et dans ses yeux, un amour si pur qu’il devient terrifiant.
Frankenstein n’est pas un film qui se regarde, c’est un film qui s’éprouve, et qui ne cherche ni la peur, ni le grand frisson gothique, mais le malaise, la compassion, la gêne. Del Toro veut qu’on aime le monstre, et qu’on s’interroge sur la part monstrueuse de notre amour.
Les dialogues, parfois ampoulés, flirtent avec le théâtral. Mais c’est voulu. Del Toro rejoue Shelley comme une tragédie classique : les héros parlent comme on prie. C’est beau, parfois trop. Mais ce trop-là fait partie du charme.
Del Toro filme la faille, le raté, la couture. Il refuse la beauté lisse. Sa créature, cousue de morceaux, est une métaphore du monde contemporain : un patchwork d’identités bricolées, d’émotions recyclées.
Le film ne répond pas, il suggère. Et c’est là qu’il est grand. Il ne cherche pas à tout expliquer. Il laisse le spectateur dans la zone grise, celle où l’amour et la monstruosité se confondent.
Del Toro, poète des damnés
Guillermo del Toro continue son œuvre de compassion. Ses monstres pleurent, ses héros saignent, ses dieux tombent. Dans Frankenstein, il parle moins de science que de filiation, moins de mort que de tendresse. C’est un film de deuil, au fond. Un film sur ce qu’on perd quand on veut tout créer.
On sort du film un peu sonné, un peu ému, un peu coupable. Parce qu’on se reconnaît. Parce qu’on a tous quelque chose du créateur égoïste et du monstre amoureux. Parce qu’on a tous aimé quelqu’un qui ne nous a pas regardés.
Et si le cinéma devait encore servir à quelque chose, ce serait bien à ça : nous rappeler que sous la peau, sous la cicatrice, sous la foudre, il y a toujours un cœur qui bat.
Sources :