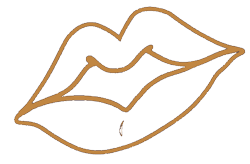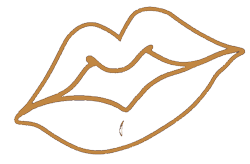Il est des films qui surgissent des ténèbres comme des souvenirs qu’on croyait enfouis. Luc Besson revient avec son Dracula, intitulé Dracula: A Love Tale. Sorti sur les écrans le 30 juillet, avec un budget de 45 millions d’euros, le film français le plus cher de l’année, est rythmé par la bande sonore signée Danny Elfman, première collaboration avec le réalisateur.
Luc Besson signe ici un retour aussi inattendu que controversé. Un come-back nocturne après des années d’ombre, de silence, et de tempête judiciaire. À 66 ans, le réalisateur du Grand Bleu et de Léon revisite la figure du vampire avec une étrangeté baroque, loin des poncifs gothiques et des capes amidonnées. Avec Dracula, Luc Besson propose un spectacle qui n’est pas un simple remake du roman de Bram Stoker, mais une relecture personnelle et éminemment romantique. Le cinéaste signe ici son film le plus ambitieux depuis Valérian.
Le Dracula selon Besson, un prince blessé, pas un monstre
Plutôt que de s’attarder sur la figure du vampire terrifiant, Besson choisit de raconter l’histoire d’un homme. Caleb Landry Jones interprète le prince Vladimir-Dracula, un être immortel hanté par la perte de son épouse et un rejet de Dieu, qui le condamne à attendre 400 ans avant de retrouver son amour. Face à lui, Zoë Bleu, fille de Rosanna Arquette, en double rôle d’Elisabeta et Mina, incarne l’amour du passé et sa réincarnation contemporaine. À leurs côtés, Christoph Waltz joue un prêtre chasseur de vampires, figure spirituelle singulière dans ce récit épique.
À la différence des Dracula habituels, Besson propose une version romantique et dramatique : un vampire qui souffre, amoureux plus qu’un monstre sanguinaire. Il ne signe pas le Dracula des cauchemars : celui d’un homme qui attend et souffre. Caleb Landry Jones, Zoë Bleu et Christoph Waltz portent le projet. Ce Dracula là, se tient, sombre et furieux. Car le style Besson est là, intact : caméra fluide, rythme syncopé, dialogues minimalistes, femmes mystérieuses et fusillades chorégraphiées. Mais un souffle plus amer traverse le film. Comme si le vampire, ce double éternel, portait aussi la fatigue d’un cinéaste qui n’a plus rien à prouver, sinon qu’il est encore vivant.
Un retour des limbes
Après Dogman en 2023, Besson avait brièvement refait surface avec June and John, sorti en avril 2025. Un film discret, quasi intime, dont peu se souviennent déjà. Une parenthèse mélancolique tourné pendant le confinement, avant le grand retour en cape noire. Le cinéaste, naguère machine à blockbusters (on n’a pas oublié Le Cinquième Élément), s’était éclipsé. Accusé par l’actrice Sand Van Roy, en 2018, la Cour de cassation le blanchit définitivement en juin 2023, mais l’opinion le relègue dans un silence polémique. Et pour cause, les procès pour viol, ont fait de lui un paria du cinéma français. Depuis, Besson s’est retranché dans un silence radio plus assourdissant que les bruits de bottes d’EuropaCorp, son studio en déroute, rachetée en 2020 par le fond américain Vine Alternative Investments.
Dracula, c’est un retour. Un vrai. Et comme souvent chez ceux qu’on pensait perdus pour la lumière, ce retour a le goût du crépuscule. Avec Dracula, il revient sans s’excuser, sans explication. Le film ne parle pas de lui, mais tout y renvoie. Dracula, ce mort-vivant haï et désiré, cet être accusé de tous les maux mais incapable de mourir, c’est lui. Un autoportrait crypté d’un homme que le monde voudrait clouer au pilori, mais qui préfère hanter les écrans.
Le prêtre interpreté par Christoph Waltz, la culpabilité divine de Vladimir, et cette mise en scène lyrique, on y devine le créateur exilé, accusé, mais jamais empêché de rêver son œuvre.
L’antithèse de Demester
À côté, The Last Voyage of the Demeter, sorti à l’été 2024, fait pâle figure. Production américaine bien huilée, adaptation sage d’un chapitre du Dracula de Bram Stoker, où le comte voyage incognito sur un bateau en route pour l’Angleterre. Un huis clos maritime, avec un vampire plus proche d’Alien que du Prince des Carpates.
Besson, lui, s’affranchit du roman et de ses codes. Il en garde l’essence : la soif, la solitude, la malédiction d’être immortel dans un monde qui change trop vite. Mais il transforme Dracula en symbole d’un Occident en décomposition, un spectre d’aristocratie traquée par ses propres fantômes.
Une œuvre terminale ?
On perçoit dans Dracula l’ombre d’un réalisateur mis à l’écart, mais qui revient armé jusqu’aux crocs. Le film ne cherche pas à effrayer : il aspire à émouvoir, à troubler. La beauté est noire, la passion est damnée, la vengeance divine flotte en arrière‑plan. C’est un vampire en quête d’amour, pas un tueur de chair. Un film terminal ? Un cri d’amour ou d’orgueil ? Peut-être un peu des deux. Mais incontestablement, un Dracula singulier, moins un interdit qu’un remords filmé.
Dracula A love table est peut-être le chant du cygne d’un homme qui a trop vu, trop fait, trop perdu. Un film en forme de confession muette, un miroir où Besson regarde son reflet sans maquillage. Le vampire est-il coupable ? Est-il victime ? Est-ce que ça compte encore ? Ce Dracula-là ne cherche pas à faire peur. Il dérange. Et ça, dans le cinéma français de 2025, c’est déjà beaucoup.