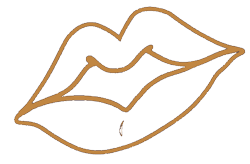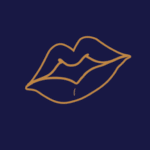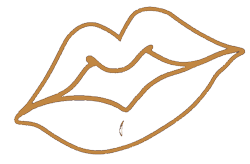Journaliste chevronnée passée par Dakar, Bamako, Zagreb ou Washington, première correspondante française à alerter sur la présence d’Al-Qaïda au Sahel, Christine Holzbauer n’a jamais cessé de mettre les mains dans la poussière des terrains que beaucoup observent de loin. Aujourd’hui, avec Mon Heure d’Afrique, elle renoue avec le front, celui des récits qui réparent plutôt que d’abîmer, et scelle un partenariat stratégique avec TRACE pour propulser ces regards africains au-delà des frontières. Rencontre avec une journaliste qui n’a jamais confondu le spectacle de la misère avec l’information.
Rapporteuses : Vous avez couvert des guerres, des trafics, des naufrages, des régimes qui s’effondrent. Aujourd’hui, vous défendez le “journalisme des solutions”. C’est une manière polie de dire que vous en avez marre de raconter l’horreur ?
Christine Holzbauer Gueye : Il n’y a pas que l’horreur, comme vous dites, en Afrique. Il y a aussi la beauté des paysages que tout le monde vante, la beauté de la savane jusqu’aux dunes des déserts du Sahara, des grands lacs ou de la forêt vierge au centre de l’Afrique. Mais surtout, il y la beauté des sourires et des âmes, du vivre ensemble dans les villages, voire dans les villes – pourtant de plus en plus surpeuplées. Evidemment, cela n’empêche pas les conflits, la destruction, la guerre. Pourquoi serait-ce différent en Afrique par rapport au reste du monde ?
Le journalisme des solutions n’a rien à voir avec l’angélisme. C’est une autre façon de voir et de parler de l’Afrique. Il n’y a ni complaisance, ni pitié, ni compromission. Lorsque ça ne va pas, on le dit. Lorsque ça marche, on le dit aussi. Chaque émission de Mon Heure d’Afrique diffuse trois reportages réalisés dans trois pays africains différents par des Journalistes Reporters d’images (JRI) locaux. C’est ainsi que l’on fait remonter les réalités de terrain pour mieux comprendre la complexité des situations. Dans le choix de ces pays, il y en a toujours un où ça marche bien, un où ça ne marche pas du tout et un qui est entre les deux. Cette façon de traiter l’information en la contextualisant et en faisant parler des « vrais » gens, au lieu que ce soit toujours les personnalités politiques à qui l’on tende en priorité le micro, change tout !
Rapporteuses : Vous avez été l’une des premières à révéler l’implantation d’Al-Qaïda dans le désert malien dès 2002. À l’époque, vous passiez pour parano ou pour casse-pieds ?
C.H.G. : Les circonstances ont fait que, en tant que reporter basée à Bamako, j’ai eu accès à un certain nombre d’informations sensibles. A l’époque, il était encore possible de sillonner le Mali de long en large, ce que j’ai fait, sans risquer d’être enlevée, rançonnée ou tuée. Le seul « ennemi » clairement identifié par les services occidentaux était celui qu’on appelait alors « Mr Marlboro », dit aussi le « Borgne », l’Algérien Mokhtar Belmokhtar. C’est lui qui avait obligé les organisateurs du Paris Dakar en 2000, puis à nouveau en 2006, à mettre en place des ponts aériens pour éviter le nord du Mali et le Niger. En 2007, des menaces du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), -qui a émergé en 1998 après que Belmokhtar et d’autres brigades djihadistes ont quitté le GIA pour fusionner avec Al-Qaïda-, les ont contraints à annuler deux étapes, la boucle Néma-Tombouctou-Néma, jusqu’à l’annulation de la course l’année d’après.
Je suis partie à sa recherche pendant six mois dans tout le nord du Mali, au Niger et, aussi, en Mauritanie recueillant des témoignages et recoupant des faisceaux d’indices qui m’ont permis de publier un reportage dans l’Express. Tout le monde me parlait d’une menace diffuse au Nord Mali, mais en la minimisant et sans jamais citer son nom. Sans doute par crainte de représailles et, aussi, parce que – je l’ai appris plus tard- il avait pris des épouses dans plusieurs tribus arabes et touarègues. Une fuite du Pentagone, reprise par la Voix de l’Amérique, a confirmé que c’était bien lui. Et les horreurs qu’il n’a cessé de perpétrer ensuite m’ont, hélas, donné raison.
A l’époque, il était encore possible de sillonner le Mali de long en large, ce que j’ai fait, sans risquer d’être enlevée, rançonnée ou tuée. Le seul
Christine Holzbauer Gueye
« ennemi » clairement identifié par les services occidentaux était celui qu’on appelait alors « Mr Marlboro », dit aussi le « Borgne », l’Algérien Mokhtar Belmokhtar.
Rapporteuses : Dans les rédactions parisiennes, on fantasme souvent une Afrique tragique, spectaculaire, exotique. Vous, vous parlez d’“une voix africaine forte et indépendante”. C’est un contrepied ou un bras d’honneur ?
C.H.G. : Un peu des deux, mon général (rires)…En fait, c’est la façon de regarder qui compte et, surtout, que ce regard vienne de l’intérieur. Dans mes émissions, les thèmes abordés sont transversaux (emploi, climat, santé, éducation, etc.) et concernent, donc, toute l’Afrique. Ce panafricanisme assumé est la plus grande force de mes émissions qui, à terme, seront -toutes- doublées en anglais, en portugais voire dans un certain nombre de langues nationales. De plus, Mon Heure d’Afrique se targue de faire de l’actualité résiliente du continent. Ce qui pourrait paraitre contradictoire dans les termes, mais ne l’est pas ! Il y a tant de talents ignorés, de compétences foulées au pied. Parfois, il suffit de tendre l’oreille -certes avec les bonnes clés et sans œillères-, pour qu’éclatent un certain nombre de vérités. Malheureusement, ces vérités sont encore trop souvent cachées. En privilégiant les narratifs produits en Afrique, c’est-à-dire in fine l’image que l’Afrique a d’elle-même et celle qu’elle renvoie ou veut renvoyer au reste du monde, Mon Heure d’Afrique sert en quelque sorte de révélateur. C’est en cela que je parle d’une « voix forte africaine indépendante » dans le choix de mes invités, parce que leur voix n’est pas inféodée, n’obéit à aucune idéologie ou autre mode médiatique du moment et qu’ils racontent l’Afrique telle qu’en elle-même.
Rapporteuses : Mon Heure d’Afrique arrive sur Trace+. 52 minutes d’histoires locales, de solutions africaines, d’initiatives qui avancent. Vous pensez vraiment qu’on peut concurrencer le storytelling catastrophiste qui remplit les JT ?
C.H.G. : Non et ce n’est, de toutes façons, pas le but ! Mes émissions sont destinées à un public africain et diasporique de jeunes qui ont besoin de donner du sens au monde dans lequel ils vivent et, surtout, de se situer par rapport au reste du monde. C’est en cela que ma rencontre avec Prescillia Avenel-Delpha, la Directrice du marketing de Trace+ et de Trace Academia, qui est basée en Afrique du Sud, a été déterminante. Elle, -comme moi-, nous voulons offrir à ce public de jeunes un accès renforcé à des récits, des savoirs et des solutions qui les concernent directement et les affectent dans leur vie de tous les jours. Comment mieux y parvenir qu’en leur présentant des talents, des créateurs et des entrepreneurs africains qui les inspirent et leur montrent la voie pour surmonter leurs propres difficultés. Sans pour autant tomber dans le bling bling, l’argent facile ou les mirages de la célébrité…
Avec les émissions de Mon Heure d’Afrique, TRACE réaffirme son rôle de passerelle entre des contenus de qualité, des plateformes innovantes et les nouvelles générations. Quant à Mon Heure d’Afrique, la licence mondiale, non exclusive, accordée à TRACE, pour une diffusion sur ses antennes, lui permet d’accroitre sa visibilité auprès de nouveaux publics en Afrique et dans les diasporas, tout en renforçant la portée de ses contenus.
En privilégiant les narratifs produits en Afrique, c’est-à-dire in fine l’image que l’Afrique a d’elle-même et celle qu’elle renvoie ou veut renvoyer au reste du monde, Mon Heure d’Afrique sert en quelque sorte de révélateur.
Christine Holzbauer Gueye
Rapporteuses : “Promouvoir un narratif africain authentique”, dites-vous. C’est quoi un récit “authentique” quand pendant trente ans, ce sont surtout des reporters blancs envoyés à l’arrache qui ont raconté le continent ?
C.H.G. : C’est vrai, mais heureusement que rien n’est jamais figé et que les choses évoluent. De plus en plus de JRI africains travaillent pour les grandes chaines de télévision occidentales. L’avantage pour eux, c’est qu’ils sont bien rémunérés et que la qualité des images qu’ils produisent répond aux standards internationaux. Ils n’en passent pas moins par les fourches caudines des perceptions -hélas, trop souvent encore catastrophistes de leur rédaction en chef ! – sur l’Afrique. Et, de toutes façons, ils ne sont pas assez nombreux pour changer le narratif sur l’Afrique dans les médias mainstream pour lesquels ils travaillent.
Ce qui change, en revanche, quand on fait travailler les JRI et les télévisions localement et qu’on les pousse à chercher des solutions aux problèmes ou aux abus qu’ils peuvent être amenés à dénoncer, c’est que l’on enclenche une nouvelle dynamique. Certes, Mon Heure d’Afrique ne va pas bouleverser le « PAF » africain à elle toute seule. Ce serait très prétentieux de le croire, mais à travers des émissions ciblées, elle peut faire la démonstration de comment un sujet aussi sensible que, -par exemple-, les migrations africaines, change de perspective quand il est vu d’Afrique.
Rapporteuses : Votre partenariat avec TRACE promet visibilité, bandeaux, boards, promotion à fond. Vous n’avez jamais eu peur que la communication dévore l’information ?
C.H.G. : Il n’y a pas de danger de collusion si l’information est vérifiée, de qualité et produite indépendamment. Ce qui est le cas, aujourd’hui, pour les émissions produites par l’association Mon Heure d’Afrique et le restera. Même en cas de co-production avec TRACE pour certaines émissions, ce qui donnera lieu à une négociation au coup par coup, je garderai la main sur les contenus en tant que réalisatrice dans le strict respect de la ligne éditoriale de Mon Heure d’Afrique. C’est d’ailleurs notre marque de fabrique que de garantir l’accès à des invités et à des experts reconnus. Ni le format, ni la rigueur dans les choix éditoriaux ne seront, à aucun moment, affectés par des campagnes de promotion de nos émissions que TRACE conduira sur ses antennes. En revanche, celles-ci constitueront un coup de pouce pour en assurer une diffusion qui soit le plus large possible.
Rapporteuses : Vous avez enquêté sur la traite des enfants, les trafics sahéliens, les manuscrits de Tombouctou, la tragédie du Joola. Entre tous ces drames, qu’est-ce qui vous a donné envie de construire plutôt que de dénoncer ?
C.H.G. : Parfois, il faut savoir prendre du recul pour essayer d’anticiper et de mesurer les conséquences à plus long terme. Cela ne veut pas dire arrêter de dénoncer les abus ou les injustices. Grand Dieu, non ! Mais, là encore, le contexte local peut demander d’aller plus loin que la simple dénonciation. Par exemple, les exciseuses, ces femmes qui « coupent » les petites filles malgré des législations rendant aujourd’hui ces pratiques ancestrales condamnables dans nombre de pays africains, bien sûr qu’il faut dénoncer de tels actes quand ils sont pratiqués. Mais pour que ça change vraiment, c’est l’approche communautaire, dans les villages, qui doit être privilégiée et mise en avant dans les médias. Pas de tabou, donc, dans le traitement de l’information mais, en revanche, un JRI n’est pas un procureur. Son travail est de montrer, pas de juger, même s’il peut participer avec ses reportages à la catharsis de la société.
Même en cas de co-production avec TRACE pour certaines émissions, ce qui donnera lieu à une négociation au coup par coup, je garderai la main sur les contenus en tant que réalisatrice dans le strict respect de la ligne éditoriale de Mon Heure d’Afrique.
Christine Holzbauer Gueye
Rapporteuses : Vous proposez aux chaînes locales africaines de les accompagner dans la création de rubriques “Vrai ou Faux” pour lutter contre les fakes news. C’est un geste journalistique ou un acte de santé publique ?
C.H.G. : Nous sommes tous victimes des fake news qui peuvent avoir des effets dévastateurs, à commencer par les campagnes de santé publique, à cause de fausses idées distillées par les réseaux sociaux sur les vaccins, par exemple ; ou bien en ce qui concerne la sécurité de nos enfants à la maison ou à l’école à cause de l’utilisation des portables si elle n’est pas surveillée. Aussi, la responsabilité des journalistes de vérifier leurs sources, particulièrement ceux qui travaillent avec les images, qui sont si facilement manipulables, est plus que jamais engagée. Je constate qu’à l’instar de ce qui se fait en Occident, l’Afrique n’est pas en reste pour dénoncer les fake news. Plusieurs organismes ont été créés depuis une dizaine d’années, partout sur le continent, et certains font un travail remarquable. Il en faut plus, bien sûr, mais ce qui manque vraiment, c’est que des rubriques Vrai /Faux soient créées au sein même des rédactions des télévisions africaines. Le seul moyen pour qu’elles deviennent pérennes. Comment y parvenir ? Là encore, Mon Heure d’Afrique propose de faire la démonstration que c’est possible en proposant d’accompagner les télévisions locales qui diffusent ses émissions pour qu’elles se lancent.
Rapporteuses : Vous avez vu l’Afrique avant les réseaux sociaux, avant les ONG 2.0, avant l’économie du like. Qu’est-ce que vous refusez de céder aujourd’hui que vous auriez déjà refusé hier ?
C.H.G. : Pas plus qu’hier, je n’accepterai aujourd’hui que l’on nie à tout être humain, quelle que soit son âge, sa couleur de peau, sa confession ou ses prédispositions- sa dignité d’être humain. Et certainement pas qu’une culture ou des cultures s’arrogent le droit d’en dominer d’autres. Cela vaut d’ailleurs sur tous les continents. En Afrique, il existe encore des liens très forts de respect des ainés, d’entraide familiale, de partage et de savoir vivre ensemble. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de tares dans la société ou qu’il ne faille pas faire évoluer un certain nombre de blocages, souvent néfastes.
Les réseaux sociaux, pour le meilleur ou pour le pire, accélèrent les bouleversements sociétaux. Nous vivons tous aujourd’hui -que ça nous plaise ou non- sous le diktat culturel des Etats-Unis. Heureusement, il y a eu et il y aura encore des résistances à ce modèle dominant de civilisation, et sans doute de plus en plus ! Mon vœu le plus cher est que l’Afrique, dans toute sa diversité et dans toute sa spiritualité, apporte sa pleine contribution. Cela veut dire qu’on l’entende, qu’on l’écoute et qu’on la voie. Personne ne pourra le faire à sa place. C’est à elle de s’en donner les moyens en développant au plus vite ses industries culturelles créatives et en protégeant ses artistes qui sont ses meilleurs porte-voix.
Plus d’infos :