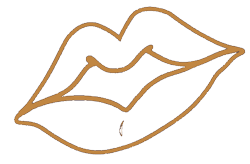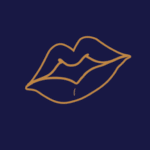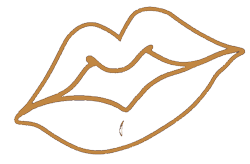Comment l’arrivée d’Emeline Hoareau chez Givenchy secoue le milieu, et pourquoi l’inclusivité ne doit plus être un mot creux. À la Fashion Week de Paris, le mannequin réunionnais Emeline Hoareau, « midsize », a défilé pour Givenchy. Une apparition rare dans un milieu encore dominé par l’ultra-minceur. Entre discours d’inclusivité et réalité du terrain, enquête sur une mode qui se dit ouverte, mais peine à s’élargir.
Paris, 3 octobre 2025. Le luxe s’est arrêté net un instant, dans la lumière crue des projecteurs de la Fashion Week. Quand Emeline Hoareau, mannequin midsize, taille 40, originaire de La Réunion, s’est avancée sur le podium de Givenchy, ce n’était pas juste une apparition : c’était une déclaration silencieuse. Une silhouette « entre-deux », ni grande-taille affirmée, ni standard filiforme, mais assez forte pour forcer le regard, réduire l’écart entre ce qui est “acceptable” et ce qui doit l’être.

“C’est une fierté d’avoir pu représenter des corps qui ressemblent à ceux qu’on croise dans la rue.”
— Emeline Hoareau, interviewée par Linfo.re
Sarah Burton, nouvelle directrice artistique de Givenchy, voulait “faire entendre d’autres voix du corps”.
Geste symbolique ? Peut-être. Mais dans le luxe, c’est un séisme feutré.
Les réseaux sociaux s’enflamment : photographies, stories, images backstage. On ne parle plus seulement de couture, de drapé ou de broderie, mais de visibilité, d’identité, d’écriture d’une mode qui reconnaisse l’humain dans sa diversité. Le mot « inclusivité » circule, parfois comme un slogan. Mais les réalités derrière restent contradictoires.
Selon Refinery29, les mannequins “midsize, entre les tailles 38 et 44, ne représentent que 4 % des défilés internationaux. Et les mannequins grande taille ? Moins de 1 % à Paris cette année.
Le mot “inclusivité” s’affiche partout, vitrines, campagnes, hashtags. Mais dans les faits ? Entre 2020 et 2025, la proportion de mannequins non standard à la Fashion Week est passée de 2,8 % à 0,8 %. (Source : Refinery29, 2025)
Certaines marques jouent la carte de la diversité le temps d’un défilé avant de revenir à la norme 34.
Les mannequins grande taille rapportent des cachets en chute libre, des castings “pour cocher la case” et des injonctions absurdes : “des hanches, mais sans cellulite”.
“Le vrai luxe, ce n’est pas l’exclusivité. C’est la liberté de s’habiller sans se nier.”
— Ester Manas, créatrice belge (Vogue France, 2024)
À contre-courant, Ester Manas, Karoline Vitto ou Sinéad O’Dwyer composent pour toutes les morphologies, sans hiérarchie. Leurs vêtements habillent la chair, pas l’effacent. Leur succès rappelle une évidence : le corps n’a pas besoin d’être corrigé pour être vu.
Et pourtant, dans les castings parisiens, le réflexe persiste : “beauté = minceur”. Les photographes continuent de retoucher la réalité. Les magazines continuent d’hésiter entre militantisme et tendance.
L’inclusivité dans la mode : un vœu, un combat
Ce petit événement, une « midsize » sur le podium d’une grande maison, jette une lumière crue sur ce que la mode dit (et ne dit pas) des corps autrement. Car l’histoire de l’inclusivité dans les défilés, plus précisément avec les mannequins de grande taille, est un récit semé d’ambiguïtés, d’espoirs, de reculs.
Depuis quelques années, plusieurs mannequins grande taille sont parvenus à se frayer un chemin sur les podiums. Des noms comme Ashley Graham, Paloma Elsesser ou Precious Lee sont devenus des symboles mondiaux de la beauté plurielle. En France, le chemin a été plus cahoteux : quelques agences comme « Plus » se sont spécialisées dans le « plus size », mais le marché, les mentalités, la rentabilité freinent les vocations.
Or, les chiffres racontent un retournement inquiétant : entre printemps-été 2020 et printemps-été 2025, la part des mannequins non standard (taille 38 et plus) en Fashion Week est passée de 2,8 % à 0,8 %. Les modèles dits « midsize » (taille 6 à 12) représentent environ 4 % dans certaines études, mais dans les coulisses du casting, leurs possibilités restent marginales.
À Paris, ce reflux est sensible. Le Monde décrit un « retour à la maigreur » : des mannequins grande taille se voient demander d’avoir « des hanches, des seins, mais pas de bourrelets ». L’injonction paradoxale « être grosse, mais sans gras » revient comme un mantra impitoyable. Certaines mannequins voient leurs revenus divisés par dix en quelques années, quitte à quitter l’Hexagone ou se réinventer.
Dans les années 90, Libération parlait de mode comme d’un terrain politique, urbain, contestataire. On dénonçait les diktats, les violences symboliques imposées aux corps, les exclusions silencieuses. À cette époque, des voix s’élevaient déjà, contre la peau, contre la maigreur, en faveur d’une mode pour tous.
Témoignages qui fissurent les certitudes
Voici ce que racontent celles et ceux qui vivent de l’intérieur ou à côté du podium :
Maud Le Fort, mannequin « curvy », Toulouse-Paris
“J’avais trop de formes pour les défilés de mode … On m’a demandé de perdre énormément de poids. Un jour j’ai dit stop, je vais manger.”
Venue à Paris à 18 ans avec des rêves de haute couture, Maud se heurte à des normes impitoyables : taille de poitrine, tour de taille, “formes admissibles”. Elle cesse les podiums mais continue les shootings photo, où les pressions sont un peu moins visibles. France 3 Régions
Sané Lou et Doralyse Brumain, mannequins grande taille
« On nous demande d’être grosse mais sans gras ! On doit avoir des hanches, des seins, mais pas de bourrelets ni de cellulite… C’est biologiquement impossible. »
Sané Lou a vu ses revenus divisés par dix en quelques années, et Doralyse dit que dans ses castings, elle doit souvent “prouver” à chaque audition qu’elle est valide, comme si son corps nécessitait une légitimité sur-montable. Le Monde.fr
Natacha, taille 44, mannequin, Belgique
« Avec ma taille 44, mes tatouages, mon crâne rasé… ça ne correspondait pas aux standards. Mais je n’avais pas prévu de décrocher. Une agence m’a repérée. »
Elle parle de son corps comme d’un argument : pas pour plaire, mais pour exister. Et souhaite que les termes comme “curvy”, “more to love”, “plus size” disparaissent, non pas en les niant, mais en les rendant inutiles comme catégories séparées. Femmes d’Aujourd’hui
Iael Joly & Marion Massat, modèles grande taille
Iael raconte la surprise des autres quand elle dit “je suis mannequin” : on ne l’imagine pas “grosse”, malgré ses missions, ses photographies. Marion, quand elle travaille hors de France, ressent que les choses sont différentes : « à l’étranger, je suis juste mannequin. En France, on me classe dans une case “curve” ». Madmoizelle
Quand Emeline Hoareau, entre sur le podium Givenchy, ce n’est certes pas un événement isolé, mais il pèse dans l’air comme une promesse : que les corps pluriels, les tailles variées ne soient plus tolérés, mais intégrés.
Aujourd’hui, revenir à ce souffle, ce fracas doux, c’est faire entendre que l’inclusivité ne doit pas être une opération de charme ou un effet de mode, mais une condition de vérité pour l’industrie. Emeline Hoareau sur le podium Givenchy ne suffit pas, mais c’est un fragment de promesse.
Quand un défilé invite un corps « intermédiaire », cela devrait devenir normal, banal. Quand des marques fabriquent en série des tailles étendues, et non en marge de leur collection, cela devrait cesser d’être un exploit. Quand les agences de mannequins valorisent l’écart, au lieu de le gommer, cela fera partie de tout.
Le combat est politique et culturel : il interpelle l’imaginaire collectif, les catalogues, les campagnes publicitaires, les murs des villes. Il dit que le luxe ne peut plus se dérober. Il appelle à une redisposition des regards.
Plus d’infos :
Ces mannequins grande taille qui défilent à la Fashion Week — Elle.fr