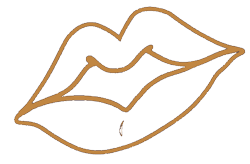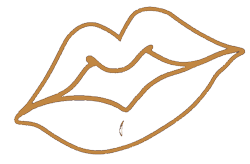Le gouvernement Lecornu bis, veut serrer la vis. Encore une. Après les arrêts maladie, voilà que la rupture conventionnelle passe au banc des suspects. L’exécutif promet d’en finir avec les « abus » en 2026, et de remplir les caisses de la Sécu. Dans le viseur : le dispositif vieux de 2008 qui permet à salarié·e et employeur·euse de se quitter à l’amiable, avec droit au chômage. Mais derrière les mots technos et les pourcentages, il y a des visages. Et celui de Sandra C., 39 ans, dit tout : « Je viens d’avoir un bébé, et la dirigeante me refuse ma rupture conventionnelle par peur que les autres femmes fassent pareil. »
Aujourd’hui, à chaque rupture conventionnelle, l’employeur doit verser une contribution de 30% du montant de l’indemnité versé à l’employé. Après la réforme, elle devrait s’élever à 40%.
Le gouvernement justifie sa démarche par le spectre du déficit de la Sécurité sociale : après un trou projeté à 23 milliards en 2025, l’objectif serait de le ramener à 17,5 milliards en 2026. Le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécu) prévoit de renforcer les recettes et de limiter les dépenses ; parmi les leviers envisagés, l’alourdissement du coût des ruptures conventionnelles fait figure de cible idéale parce qu’il semble populaire, utilisé massivement, et à portée budgétaire directe.
Cette augmentation du coût pour les patrons pourrait réfréner leurs utilisations. En 2024, plus d’un demi-million…Autrement dit, chaque rupture « négociée » deviendrait un peu plus chère pour l’employeur, et donc, potentiellement, un peu plus risquée à concéder.
Dissuader les patrons d’utiliser la rupture conventionnelle comme un licenciement déguisé, sur le papier, ça se défend, dans la vraie vie, ça coince.
« Ce ne sont pas les grands groupes qui vont souffrir, » soupire Sandra. « Ce sont les PME, les salariées comme moi, les femmes qu’on bloque entre le congé maternité et le licenciement. »
Résultat : les PME hésitent, les RH se crispent, et les Sandra se retrouvent piégées entre un congé maternité trop court et un retour impossible. Sandra nous a contacté, elle est fière dit-elle de mener ce combat, pour elle, et les autres femmes.
« Quand on fait un enfant, on anticipe »
Sandra bosse depuis trois ans dans une PME de trois salariés. Trois ans d’investissement sans relâche, de tableaux Excel jusqu’à pas d’heure, de clients sauvés à la dernière minute. Elle a tout donné, sans jamais rien réclamer. Pas même une augmentation, juste des primes « pour arranger la boîte ».
Puis elle est devenue maman. Son premier enfant, à 39 ans. Et c’est là que la machine s’est grippée.
« Je viens d’avoir un bébé, et la dirigeante me refuse ma rupture conventionnelle par peur que les autres femmes fassent pareil », raconte Sandra. La phrase tombe, sèche.
La direction ne veut pas « ouvrir la boîte de Pandore ». « Quand on fait un enfant, on anticipe », lui répond sa bosse. Traduction : débrouille-toi, mais reste productive.
Un refus qui dit tout
Dans la PME de Sandra, le chiffre d’affaires a triplé en trois ans. Les félicitations, oui. La souplesse, non. Sa patronne n’accorde la rupture qu’aux salariés jugés « non rentables ». Et surtout pas à une jeune mère.
« Elle m’a dit que m’accorder ce départ enverrait un mauvais message au reste de l’équipe, composée de femmes en âge d’avoir des enfants. »
En 2025, il faut encore entendre ça. La maternité, soupçonnée d’être contagieuse.
Sandra se retrouve piégée. Pas de place en crèche, pas de budget pour une nounou à temps plein, un père retraité obligé de traverser la ville chaque jour pour garder le bébé. « Je ne cherche ni conflit ni revanche, dit-elle. Je veux juste qu’on arrête de punir les femmes pour avoir donné la vie. »
Rupture à double tranchant
Sur les plateaux de BFM, les éditorialistes parlent « d’optimisation sociale ». Dans les couloirs des RH, on parle surtout d’étouffement. Le dispositif, qui permettait une sortie sans guerre, risque de devenir un champ de mines. Les patrons réfléchiront à deux fois. Les salarié·e·s, se tairont trois fois.
Et les Sandra de France devront choisir entre reprendre trop tôt, démissionner sans droits, ou craquer en silence.
Sur le papier, la mesure veut « réguler ». En pratique, elle rigidifie. Ce qui était une zone de respiration dans le CDI devient une cage. La France du travail « à l’amiable » s’en va, étouffée sous la ligne budgétaire.
Et les mères, dans tout ça ?
La rupture conventionnelle, pour beaucoup de femmes, c’était la dernière issue légale avant le gouffre. Pouvoir souffler, réorganiser sa vie, rebondir ailleurs sans passer pour une traîtresse. Aujourd’hui, la porte se referme. « Derrière les beaux discours sur l’égalité et le bien-être au travail, beaucoup d’entreprises continuent à voir la maternité comme une menace, » conclut Sandra. Et quand l’État décide de taxer plus fort ces départs, il cautionne, indirectement, cette logique : punir le départ, glorifier l’endurance.
Ce que dit Sandra dans son post, entre deux phrases tremblées d’émotion, c’est le quotidien d’une France au bord du burn-out maternel. Celle qui bosse sans se plaindre, mais à qui on reproche de ne plus pouvoir tout concilier. Celle qui découvre qu’en 2025, la maternité reste un risque professionnel. Et tant pis si les places en crèche sont inexistantes, les nounous hors de prix et ton père retraité, qui doit faire deux heures de trajet par jour pour garder le bébé.
En 2008, la rupture conventionnelle était un progrès : la preuve qu’on pouvait se séparer sans violence.
En 2025, elle devient un symbole : celui d’un État qui durcit quand les femmes flanchent, d’un patronat qui tremble devant l’idée qu’elles choisissent. Pendant ce temps, on continue à féliciter les mères courage, mais uniquement celles qui ne demandent rien.
Sources :