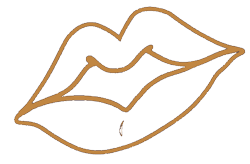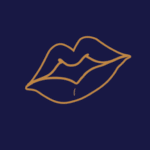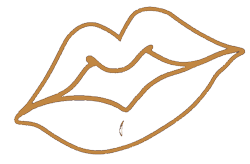L’Australie interdit à partir du 10 décembre, l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans, devenant ainsi le premier pays occidental qui assume de poser une limite réelle. La France sous pression politique et sociale, affiche l’intention d’abaisser, à 15 ans, l’âge minimal d’inscription, mais le projet se heurte aux réalités juridiques, techniques et européennes.
À partir du 10 décembre, les moins de 16 ans n’auront plus le droit de mettre un pied, même virtuel, sur les réseaux sociaux en Australie. Une décision radicale, presque iconoclaste, à l’heure où les plateformes ont colonisé l’attention mondiale. C’est la profondeur d’un geste politique rare, presque violent, mais radicalement clair : “hors du virtuel, vous êtes mineurs”. Une loi qui n’empêche pas certaines familles parents de jeunes adultes, de regarder impuissantes, leurs enfants glisser dans une dépendance aussi distrayante que dévastatrice.
Elle s’appelle Nadia, 48 ans, mère d’un garçon de 20 ans. Une femme sans histoires, sans catastrophes, mais avec un drame qui la fait souffrir en silence : celui de voir son fils disparaître, lentement, absorbé par un téléphone qui lui dévore le regard. “Il est complètement abruti par les réseaux sociaux”, dit-elle à bout, “surtout TikTok“. Son téléphone le suit partout, aux toilettes, dans la salle de bain, et chaque dîner devient un tête-à-tête avec son portable. Son fils n’a pas de petite amie, sort très peu, les conversations avec lui se dissolvent dans un “attends deux secondes”.
Nadia ne parle pas d’une addiction spectaculaire, comme avec les stupéfiants. Sous son toit, il n’y a pas de cris, de crise, juste une présence absente, un enfant devenu “flux”, un cerveau “scrolleur”, un être humain majeur, avec lequel elle ne converse plus, pris dans une machine conçue pour qu’il ne regarde plus jamais ailleurs. Ce fils de 20 ans est pourtant un symbole : celui d’une génération qui glisse hors du tangible, dans une économie attentionnelle qui ne lui veut pas du bien.
Le gouvernement australien lui n’a pas tergiversé. A partir d’aujourd’hui, les mineurs de moins de 16 ans seront légalement bannis des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube : tous hors de portée. Officiellement, pour protéger la santé mentale. Officieusement, pour reprendre la main sur une industrie devenue trop puissante, trop intrusive, trop cynique.
La France : un pas en avant, deux commissions en arrière
Il y a des annonces politiques qui ont le goût d’un vieux slogan rincé. Et puis il y a celles qui ressemblent à une opération commando sur la jeunesse, emballée dans un discours anxieux sur la « protection des enfants ». Depuis l’automne, les propositions se bousculent : interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, portable banni du lycée, pause numérique généralisée, contrôle parental renforcé, responsabilisation punitive des plateformes. Une avalanche réglementaire, comme si l’exécutif avait découvert d’un seul coup que TikTok, Snapchat et Instagram existaient.
Mais derrière ce volontarisme législatif, il y a autre chose : un malaise politique, un aveu d’impuissance face aux géants du numérique, et l’éternelle tentation française de gouverner par l’interdit faute de stratégie.
Quand les députés Renaissance ont déposé leur proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans, plusieurs juristes ont sauté au plafond. Non pas que la question soit illégitime, la santé mentale des ados est une urgence, mais parce que l’Europe n’a pas prévu de seuil d’âge uniforme. Résultat : impossible d’imposer en France ce que Bruxelles n’a pas harmonisé.
Le Digital Services Act (DSA), entré en vigueur en 2023, encadre les plateformes, mais ne fixe ni âge minimal uniforme, ni mécanisme fédéral de vérification. La Commission européenne elle-même, dans une note publiée en octobre 2024, rappelait que « toute restriction généralisée d’accès par l’âge doit être compatible avec la libre prestation de services », c’est-à-dire quasi impossible à appliquer pays par pays. Autrement dit : Paris parle fort, mais c’est Bruxelles tient la télécommande.
Portable interdit au lycée : une mesure symbole ?
Depuis juin 2025, le chef de l’État Emmanuel Macron s’est dit prêt à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans si l’Union européenne ne le faisait pas, et va plus loin en voulant l’interdiction des portables dans les collèges et les lycées à la rentrée prochaine. L’Élysée jure que tout est prêt, que les surveillants seront renforcés, que les casiers arriveront, mais dans les faits, rien n’est prêt. Le Conseil national de la vie lycéenne n’a pas été consulté. Les syndicats alertent : sans moyens humains, c’est juste une consigne impossible à appliquer. Qui va surveiller, confisquer, stocker, sanctionner ? Déjà que la loi de 2018, sur les portables dans les collèges n’a jamais été pleinement appliquée, les professeurs font savoir qu’ils n’ont ni le temps ni les moyens de jouer les vigiles numériques.
D’après une note interne du ministère, révélée par Les Échos, il faudrait entre 12 000 et 15 000 AED supplémentaires pour faire respecter la mesure au quotidien. Budget estimé : entre 280 et 350 millions d’euros par an. Pour le moment, rien n’est provisionné. On est loin du « choc d’autorité numérique » promis par l’exécutif.
Des ados désorientés, des parents dépassés
Dans une étude de de l’INSEE publiée en octobre 2025, 28 % des collégiens et 23 % des lycéens sont victimes de violence en ligne. En 2024, les atteintes en ligne constituent 12 % des atteintes à la personne enregistrées par les forces de sécurité intérieure, en nombre de victimes. Le harcèlement en ligne, l’une des formes de cyberviolence les plus courantes, représente 35 % des délits de harcèlement. Le constat est réel, alarmant, documenté. Mais le débat politique, lui, reste paresseux. Rapporteuses a rencontré une CPE francilienne, qui résume la situation : « On met tout sur le dos des ados. Mais les problèmes arrivent parce qu’on n’a jamais formé les adultes. Les parents n’ont aucune grille de lecture, et l’école n’a jamais eu les moyens d’éduquer au numérique. »
Car c’est bien là le cœur du problème : la France a vingt ans de retard sur l’éducation aux médias, et cherche aujourd’hui à rattraper son absence de politique numérique par un coup de menton réglementaire.
Une jeunesse déjà à bout de souffle
Le gouvernement parle d’addiction aux écrans comme si les adolescents vivaient dans une bulle technologique coupée du réel. Mais les vrais chiffres racontent autre chose. Selon une récente étude de l’Insee publiée le 4 septembre, 10% des jeunes vivent encore chez leurs parents à 26 ans en raison de différentes contraintes, notamment budgétaires. Certes les écrans prennent trop de place, mais c’est aussi parce qu’ils sont devenus un refuge dans une société qui parle beaucoup de jeunesse… mais qui ne lui offre pas de perspectives.
Les plateformes, les grandes gagnantes du flou
Pendant que Paris menace, les plateformes, elles, négocient. Elles savent que la France ne peut rien imposer toute seule. Le DSA leur impose des obligations (transparence, modération, accès aux données pour les chercheurs), mais sur l’âge, elles restent maîtresses du jeu. Comment vérifier l’âge sans collecter plus de données ? Comment créer un système fiable sans tomber dans la surveillance généralisée des mineurs ? La sociologue Cécile Van de Velde résumait récemment : «On veut protéger les ados sans jamais se demander de quoi on veut les protéger exactement. De leurs écrans ? Ou de l’absence de perspectives qu’on leur offre ? »
Le casse-tête européen. Le RGPD interdit la surveillance massive, la collecte intrusive de données biométriques, et complique tout mécanisme de vérification obligatoire de l’âge. Et rien ne peut être décidé sans Bruxelles, qui avance au ralenti sur ces questions.
Les plateformes devraient prouver qu’un utilisateur a 15 ans ou plus. Mais comment ? Carte d’identité, reconnaissance faciale, justificatif bancaire ? Les solutions sont lourdes, coûteuses, et contestables du point de vue de la vie privée. Certains États qui avaient envisagé des mesures radicales ont reculé, découragés par le maquis juridique ou la résistance des plateformes. Cela rend le pari français, et européen, particulièrement risqué : imposer un cadre unique pourrait fragiliser la cohésion du marché numérique ou favoriser la fuite vers des plateformes « hors règles ».
Le cadre juridique européen : selon des experts, un pays seul ne peut pas imposer des règles plus strictes que celles prévues par le cadre européen (le Digital Services Act — DSA). Or le DSA n’exige pas de vérification universelle de l’âge pour l’inscription aux plateformes. Le contournement technique : un VPN, un simple âge déclaré, et le verrou saute. Beaucoup d’enfants et d’adolescents utilisent déjà de telles méthodes. Vérifier à l’échelle mondiale, sur des plateformes installées en Irlande, aux États-Unis, en Asie, relève du défi quasi insurmontable. Ce casse-tête européen pose une question fondamentale : voulons-nous un internet fragmenté, fondé sur des accords franco-nationaux, ou un espace numérique commun, protégé, mais régulé de façon cohérente ? Jusqu’à présent, l’équilibre semble introuvable. Autrement dit : le projet est séduisant, mais, aujourd’hui, il risque d’être, au mieux, symbolique, au pire inefficace.
Le geste de l’Australie, en théorie, semble radical, mais si l’on veut protéger les jeunes d’un numérique toxique, il ne suffit pas de poser des interdictions ou des seuils d’âge, il faut un véritable projet de société. La tentative française, avec un seuil à 15 ans, montre qu’il y a enfin une conscience politique, un réveil face à une addiction collective. Mais sans moyens, sans vision globale, sans cadre européen, c’est un coup de jokari contre un tsunami numérique.
Sources :