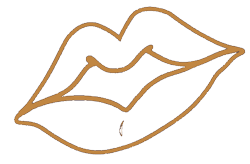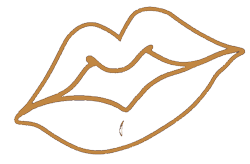Avec nos vies pressées, nos assiettes se sont vidées de leurs rituels. Manger, oui, mais souvent sur un coin de table, devant un écran ou dans le brouhaha d’un open space. Pourtant, en 2010, l’Unesco inscrivait le repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Une première mondiale. L’art de la table devenait patrimoine au même titre qu’un temple, un chant ou un carnaval. La France pouvait bomber le torse : sa gastronomie, c’est du sérieux. Sauf que. Qui, aujourd’hui, prend vraiment le temps de dresser une nappe, d’aligner verres et couverts, de savourer un repas comme un rituel ? Hors des grandes maisons et des tables bourgeoises, le cérémonial se fait rare. Les hypermarchés, eux, ont recyclé le terme « arts de la table » en une gamme de vaisselle, de nappes et de gadgets pour l’apéro. Le décor reste, le sens s’effrite.
Vendredi soir, 20h. Sur la table basse, une pizza encore tiède, deux canettes, un écran allumé en fond sonore. Pour beaucoup de Français, le « repas gastronomique » ressemble désormais à ça. Pas de nappes, pas de verres à pied, pas de plats en sauce qui mijotent des heures.
Et pourtant, depuis 2010, l’Unesco classe ce rituel hexagonal au patrimoine immatériel de l’humanité. Comme si la blanquette de veau et le gigot du dimanche jouaient dans la même division que les temples d’Angkor.
Une pratique qui s’effiloche
À l’époque, la France s’était auto-couronnée reine de la fourchette. Une première : aucun pays n’avait encore vu sa gastronomie inscrite au registre des trésors mondiaux. L’Unesco parlait d’un « art social », d’un moment de partage, d’une communion entre nature et culture. Mais dans les faits, combien dressent encore une table avec serviettes en tissu, assiettes qui s’emboîtent et verres alignés comme des soldats ?
L’Unesco insistait sur l’essentiel : « être bien ensemble », célébrer les moments qui comptent. En clair : manger, oui, mais pas seul. Partager. Or, à force de fast-food, de repas avalés en vitesse, de confinements successifs, on a fini par oublier la dimension sociale de ce rituel. Ce qui était codifié, couteau à droite, fourchette à gauche, devient exotique.
Le repas français, tel que l’Unesco l’a sanctuarisé, insistait pourtant sur l’idée de célébrer les moments-clés : mariages, anniversaires, naissances. Mais aujourd’hui, ces rites s’effilochent. La pandémie a achevé de bouleverser les habitudes : visio-apéros, anniversaires à distance, réveillons à six. Un art social réduit à un écran partagé.
Dans les grandes surfaces, « les arts de la table » se résument désormais à des rayons remplis de verres à cocktail, de bougies parfumées et de nappes plastifiées made in China. La convivialité se vend en kit. « Avant, chez mes grands-parents, on sortait l’argenterie, on mettait trois verres différents, on mangeait pendant des heures », raconte Jeanne, 42 ans, cadre à Paris. « Moi, avec mes enfants, c’est pâtes devant Netflix. »
Transmettre avant que ça ne disparaisse
Reste la question : comment sauver ce patrimoine ? Les institutions misent sur l’éducation, l’école, pour transmettre aux enfants un art qui se perd. Leur rappeler qu’un repas, ce n’est pas qu’un plein d’essence pour le corps, mais un moment de culture, de lien, de mémoire. Et que ce patrimoine, paradoxalement, ne vit que s’il est pratiqué au quotidien. Car un art de vivre n’a pas vocation à finir dans un musée.
Dans les écoles, quelques programmes tentent d’initier les enfants au « goût », de leur apprendre qu’un repas est autre chose qu’un sandwich avalé à la récré. Mais qui leur explique encore que le couteau se place à droite, la fourchette à gauche ? Qui leur montre que manger, ce n’est pas seulement se nourrir mais célébrer un moment ?
« Si on n’y prend pas garde, dans vingt ans, le repas gastronomique des Français ne sera plus qu’une ligne dans un rapport de l’Unesco », prévient un anthropologue du goût. Un patrimoine vivant devenu musée. Une tradition réduite à des souvenirs du dimanche midi, coincée entre un bol de chips et une barquette micro-ondes.