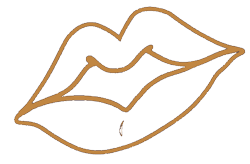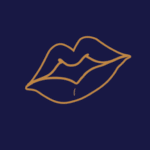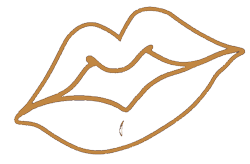Hier matin, en plein Paris, sous la pyramide de verre de Pei : le Louvre s’est fait plumer. Des bijoux inestimables, envolés au nez et à la barbe des caméras, des gardiens, des touristes, et du fantôme de Napoléon. Le genre de coup qu’on croyait réservé à la fiction, aux voleurs bien mis et aux scénarios qui sentent le cuir et la Gauloise. Mais non : bienvenue dans Louvre 2025, saison 1, épisode « Tout fout le camp ».
Le Louvre, dimanche 18 octobre, aux alentours de 9 h 30, peu après l’ouverture du musée le plus visité au monde, pendant que des touristes dégainaient leur appareil photo, et que les agents de sécurité bâillaient, quelque part sous la pyramide de verre, dans la galerie d’Apollon, des mains gantées dérobaient selon le ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez : des bijoux d’une « valeur inestimable ». Pas une trace, pas un cri, juste un silence, celui qu’on entend dans les films avant la bande-son. Un commando de quatre malfaiteurs s’est emparé de huit bijoux du XIXe siècle avant de prendre la fuite, en sept minutes seulement.
« Nous retrouverons les œuvres et les auteurs seront traduits en justice », a déclaré Emmanuel Macron, sur X. « Tout est mis en œuvre, partout, pour y arriver », a promis le chef de l’Etat, ajoutant « une atteinte à un patrimoine que nous chérissons car il est notre histoire ». Des bijoux du patrimoine français volés sous le nez des caméras, le genre de casse qu’on croirait sorti d’un vieux scénario oublié de Melville ou d’un épisode de Lupin revisité.
On imagine déjà le pitch : six types en gilet jaune, une ingénieure réseau, un bruit sourd dans les galeries, un tableau qui penche, et hop, rideau. Ocean’s Eleven aurait souri. Clooney et Pitt auraient signé la mise en scène, caméra à l’épaule et sourire en coin, avant de s’enfuir en décapotable vers la Riviera. Sauf qu’ici, pas de glamour, pas de champagne, juste une alarme en panne et des bijoux qu’on ne reverra peut-être jamais.
Entre mythe, cinéma et faits divers, retour sur un art français : celui de voler avec panache.
Le cinéma et la liturgie du casse
Dans les romans de Maurice Leblanc, Lupin annonçait ses larcins comme on envoie un faire-part. Il volait avec panache, soignait sa mise en scène et respectait ses victimes. Il incarnait une morale du vol, celle du gentleman, du rebelle lettré qui détestait la vulgarité.
Les voleurs, eux, n’ont sans doute jamais lu Arsène Lupin. Trop de style, trop de mots. Le gentleman cambrioleur, annonçait ses larcins par politesse, dorénavant les voleurs ne signent plus leurs forfaits. Ils effacent leurs traces, cryptent leurs échanges, roulent en scooter. Le style a foutu le camp. Lupin aurait rendu les bijoux, par principe. Aujourd’hui, on revend sur le dark web entre deux livraisons Uber.
De Lupin à Clooney, en passant par la Panthère Rose et les gentlemen cambrioleurs en smoking, le grand art du vol renaît, mais sans l’élégance ni la morale.
Nice, 1976. Spaggiari creuse un tunnel sous la Société Générale. Pas d’armes, pas de sang, juste un mot : « Sans armes, ni haine, ni violence. » Le casse du siècle, 50 millions de francs et une évasion spectaculaire. Certes, il faut le condamner, mais difficile de ne pas admirer le culot, l’intelligence, l’odeur de gauloise et de cambouis. Spaggiari, c’était la dernière figure d’un vol qui se voulait libre et presque philosophique.
Avant le héros romantique, il y eut le monstre. Fantômas, génie du crime, sans visage ni remords, échappait à la justice avec la légèreté d’un diable mondain. Il ne volait pas pour vivre : il vivait pour voler. Dans son sillage, des générations entières ont rêvé du frisson du crime, celui où la frontière entre le bien et le mal se dissout dans la brume bleutée d’un Paris d’avant. Le vol comme art, la fuite comme poésie. Fantômas aurait adoré le Louvre : symbole parfait du pouvoir et de la beauté à dépouiller.
Fantômas avait des masques, Lupin des gants blancs, Spaggiari un tunnel. Nos voleurs du jour ont des brouilleurs et un GPS. Le crime, lui aussi, s’est ubérisé.
Le cinéma, lui, n’a cessé de rejouer le fantasme du casse parfait. La Panthère rose faisait danser la maladresse sur fond de jazz. Topkapi filmait des acrobates suspendus à des fils invisibles, des corps graciles défiant la gravité et l’État. Même Rififi chez les hommes, de Dassin, offrait au cambriolage une pure séquence muette, chorégraphiée comme un ballet noir et blanc sans un mot, sans une faute.
Les Américains, eux, ont fait du cambriolage un genre à part entière. Ocean’s Eleven, The Italian Job, Inception : le crime devient chorégraphie. Clooney sourit, les lasers dansent, les coffres-forts s’ouvrent sur des jazz élégants. Tout est beau, millimétré. Et voilà qu’en 2025, le réel se remet à parodier la fiction. Le Louvre devient décor de polar, la République, théâtre de l’absurde. Le musée le plus célèbre du monde, braqué comme un piratage de compte bancaire. On apprend que la sécurité manquait de budget, que les alarmes étaient en révision, que les caméras « dysfonctionnaient ». Autrement dit, le scénario parfait pour un Lupin 3.0.
Mais qu’on se rassure : le mythe français du voleur élégant survit toujours dans les séries Netflix. Arsène reste vivant, quelque part entre Rouen et la fibre optique. Peut-être qu’au fond, ce casse du Louvre est juste un hommage involontaire, brutal, à tout un siècle de littérature et de cinéma qui avait fait du crime un art. Sauf qu’ici, l’art s’est fait voler. Et ça, ce n’est plus du cinéma, et la nostalgie ne ramènera pas les bijoux.
Reste une évidence : si le Louvre s’est fait dépouiller, c’est que l’État a baissé la garde et la culture, la tête. Le musée le plus célèbre du monde n’a plus besoin de voleurs pour être vulnérable, il suffit d’un budget coupé, d’un service en sous-effectif, et d’une administration en panne.