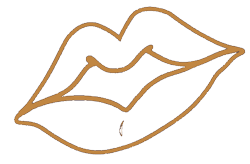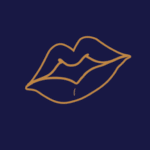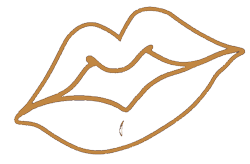Dix ans après la nuit où Paris s’est figé sous les balles, la République se recueille. Le Bataclan, les terrasses, le Stade de France, trois points sur la carte d’un cauchemar collectif. Mais au-delà des gerbes et des hymnes, il reste les invisibles : ceux qui n’y étaient pas, mais qui portent, eux aussi, les stigmates d’un drame qu’ils n’ont fait qu’écouter. Le traumatisme vicariant, c’est l’autre onde de choc du 13 novembre.
C’était un vendredi, pas superstitieux pour un sou. Des terrasses animées dans le 10ᵉ et le 11ᵉ, des cafés, restaurants. Paris riait, trinquait, vibrait. Ce soir-là pendant un match au Stade de France, 21 h 16, la première bombe explose. Dix minutes plus tard, les rafales dans les cafés du 10e, puis le Bataclan, 90 morts dans cette salle de concert mithyque. Dix ans après, le calendrier fait mal. La ville rallume ses bougies, repeint sa mémoire en bleu-blanc-rouge, mais les cicatrices ne sont pas que sur les murs.
Depuis, les lieux se sont transformés. Le Bataclan a rouvert ses portes, des plaques commémoratives ont été gravées, le Jardin du 13 novembre 2015 inauguré près de la mairie de Paris, mais la mémoire n’est pas achevée. Le travail psychique commence parfois tard.
Un rescapé confiait sur le site de Reuters :
« Une partie de moi est restée au Bataclan. »
Il évite les foules, les lieux clos, retrouve les bruits de tirs dans un feu d’artifice. Le souvenir ne part pas. Il persiste, rampant sous la peau.
Et puis il y a ceux qui n’étaient pas là mais qui ont assisté. Ceux qui ont entendu les cris sur les ondes, ceux qui ont assisté aux procès, ceux qui ont lu les témoignages et les dossiers. Ils portaient le relais de l’horreur. Le traumatisme vicariant prend racine dans ce relais.
Parce qu’entre les survivants, les proches, les témoins directs, il y a eu tous les autres. Les psys, les flics, les juges, les journalistes, les infirmiers de garde et même les voisins qui ont écouté les récits jusqu’à l’écœurement. Eux n’ont pas vu le sang, mais ils ont pris les mots en pleine figure. Le Cn2r appelle ça le traumatisme vicariant. En clair : se prendre le traumatisme des autres, à force d’écouter, de compatir, de porter.
Et là, silence radio. Pas de cellule d’aide, pas de médaille, pas de minute. Ces « transferts » de douleur, ces nuits sans sommeil, ces cauchemars empruntés, ne se déposent pas sur un registre officiel. Pourtant, dix ans après, ils continuent à en baver.
Le plus dingue, c’est que cette souffrance-miroir, on la retrouve partout : dans le corps médical lessivé, les avocats des parties civiles, les bénévoles des associations, les journalistes d’audience. À force de tendre l’oreille, ils ont laissé l’horreur s’y glisser.
Il ne s’agissait pas de voir la violence de ses propres yeux : ce pouvait être entendre le témoignage d’un collègue, lire le dossier d’un survivant, ou visionner les images insoutenables après coup. C’est ce que vivent les juges, les soignants, les secouristes : l’horreur transmise, internalisée, sans avoir été à l’origine.
L’empathie, vertu première des métiers d’aide, se révèle doublement tranchante : elle fait lien, mais elle ouvre une brèche dans la limite entre l’autre et soi. Le professionnel peut devenir, sans le vouloir, miroir de la détresse.
Pourquoi tant insister sur ce « vicariant » ?
Parce que :
Les cérémonies, les plaques, les minutes de silence, tout cela honore la mémoire. Mais cela ne touche pas toujours les travailleurs silencieux qui, après la nuit du 13, ont encaissé des récits, ont traversé les procès, ont accompagné des familles détruites.
Cette forme de traumatisme est peu visible : elle n’est pas liée à la prise de balle, à l’éclat de verre, mais au poids d’être témoin, d’être porteur de la souffrance d’autrui, d’être « celui qui aide » et qui reçoit aussi.
À l’occasion de cette commémoration, nous devons rappeler que le soin ne se limite pas à l’événement « principal » : il faut penser à tous ceux qui ramassent les débris, ceux qui « écoutent », ceux qui relaient.
Les cérémonies de ce 13 novembre 2025 sont pleines de bougies et de discours compassés. Hollande, Macron, Hidalgo, tout le monde pleure à la télé. Mais qui écoute ceux qui ont écouté ? Qui soigne les soignants ? Qui répare ceux qui réparent ?
Parce que la mémoire, ce n’est pas juste des plaques et des fleurs. C’est un poids qui se partage, un choc qui rebondit. Dix ans après, la France se tient droite, dit-on. Mais en dessous, ça tremble encore.
Ce que cette commémoration exige
Au-delà de la minute de silence, des gerbes, de la lumière de la tour Eiffel qui s’illumine en bleu-blanc-rouge. Il faudrait selon Cn2r :
Reconnaître l’impact psychique pour les intervenants de la mémoire : soignants, magistrats, journalistes, bénévoles.
Créer des dispositifs de soutien spécifiques, adaptés aux mécanismes du traumatisme vicariant (et non uniquement ceux du vécu direct). Le dossier du Cn2r relève que les stratégies sont encore peu développées.
Faire vivre la mémoire comme un acte de solidarité vivante : pas seulement « ce qu’il s’est passé », mais « ce qu’il reste à réparer ». Le traumatisme ne se compte pas seulement en morts, mais en vies interrompues, en échos infinis.
Le 13 novembre, ce n’était pas seulement une nuit d’horreur : c’était un jour où la confiance s’est fissurée, où la ville-monde a tremblé, où la musique a été interrompue. Dix ans plus tard, nous sommes encore debout, mais pas indemnes. L’effroi a laissé des traces ; invisibles pour certains, mais tout aussi réelles.
Aujourd’hui, il faudrait entendre aussi le chuchotement du traumatisme vicariant. Ecouter ceux qui souffrent d’avoir aidé. Ne pas oublier que la mémoire collective repose aussi sur ceux qui ont été témoins et qui continuent de vivre avec ce qu’ils ont entendu, vu, porté.
Parce que la liberté ne se reconstruit pas par la seule invocation du souvenir : elle se soutient aussi par la reconnaissance de ceux qui tiennent la mémoire et qui, parfois, payent en silence.
Sources :