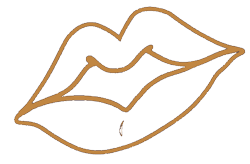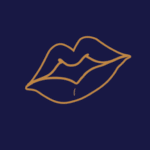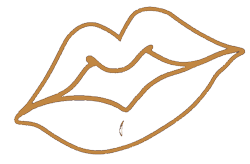Il faut parfois se méfier des contes qui annoncent leur ambition morale trop tôt : ils finissent souvent par s’effondrer sous leur propre gravité. Wicked : Part II, en salle depuis le 19 novembre, conclusion d’un diptyque dont Hollywood attendait une rédemption musicale, n’échappe pas à ce phénomène. Le film est somptueux, presque trop. Une carte postale numérique du pays d’Oz, repeinte en vert émeraude comme pour masquer la fissure grandissante entre ce qu’il proclame, un récit sur le pouvoir, la désinformation, la marginalité, et ce qu’il accomplit réellement.
Deux sorcières, un seul combat… mais des ailes trop petites pour voler
Sur le papier, Glinda (Ariana Grande) et Elphaba (Cynthia Erivo) sont les héroïnes rêvées d’un cinéma féministe contemporain : deux femmes, puissantes, intelligentes, confrontées à un système patriarcal et autoritaire qui veut les opposer pour mieux les briser. Dans un Oz dirigé par un magicien ventriloqué par ses communicants, dénoncer la manipulation médiatique a tout du geste radical.
Mais la mise en scène se dérobe. Les moments de vrai courage, politique, intime, sororal, sont avalés par le ronronnement du blockbuster : des chansons façonnés, des robes en CGI, des ralentis pseudo-émouvants. La relation entre Glinda et Elphaba, pourtant cœur battant de l’histoire, est souvent survolée. Ce qui pourrait être une tragédie féminine sur la loyauté, la jalousie, la résistance devient un soap cosmique, joli mais tiède. Le féminisme de Wicked, c’est celui des slogans Instagram, pas celui des luttes.
Hollywood repeint le colonialisme en vert émeraude
Wicked se veut un conte politique. Mais quand on gratte le vernis, Oz, c’est encore le bon vieux fantasme occidental : une cité-État tout-puissant qui décide quels peuples ont le droit d’exister, lesquels doivent être expulsés, remodelés, dressés. Dans le traitement des Munchkins, des Animaux, des peuples « non conformes », on reconnaît les fibres post-coloniales du texte d’origine, oppression, assimilation, effacement culturel.
Mais là encore, le film ne va jamais au bout de ses propres métaphores. La violence coloniale est esthétisée, polie, presque… confortable. Les peuples opprimés sont réduits à des silhouettes exotiques, victimes de service destinées à faire briller la conscience morale d’Elphaba. Dans un récit qui prétend dénoncer l’oppression, la caméra reste pourtant accrochée au point de vue de celles qui ont accès au pouvoir, d’une Blanche célèbre et d’une Noire exceptionnelle, mais seules habilitées à comprendre et réparer le monde. Un anti-colonialisme qui n’interroge pas les privilèges des personnages… ni ceux de Hollywood. Wicked II veut condamner le système, mais sans froisser personne.
Le Magicien, prototype parfait du colon dominateur made in USA
Le dictateur d’Oz, ce Magicien imposteur, c’est le colonisateur en version tech : charmeur, mensonger, paternaliste, fabriquant de l’ordre par le mensonge et la terreur. Une figure politique passionnante, mais la satire reste timide. Comme dans trop de blockbusters américains, on dénonce le pouvoir sans jamais questionner les structures. On fustige l’autoritarisme, mais dans un cadre où le système peut être sauvé, pourvu qu’une héroïne morale l’habite.
La figure du Magicien est un miroir à peine voilé de notre ère post-vérité. C’est un dirigeant sans pouvoir réel, un communicant devenu chef d’État, un technicien de l’illusion plus qu’un tyran. Le type de despote qui ne crie jamais : il diffuse.
“Wicked” a toujours voulu dire plus que ce qu’il chante. Son ambition est noble, presque classique : raconter, derrière la magie, l’accumulation de peur, d’ignorance et de pouvoir qui transforme une jeune femme en menace publique.
Mais dans cette seconde partie, le film ne sait plus s’il veut être un manifeste ou un spectacle. La dramaturgie se dilue dans des numéros musicaux exécutés avec précision, mais rarement avec nécessité. On devine l’intention, dénoncer la fabrication médiatique de la peur, la façon dont les institutions transforment la dissidence en monstruosité, mais le scénario est trop poli, trop prudent, pour entrer dans la zone dangereuse où les contes deviennent réellement subversifs.
Glinda, ou la fabrication du consensus
Ariana Grande joue une Glinda lumineuse, mais le personnage souffre d’une contradiction structurelle :
elle incarne le privilège, la légèreté, le pouvoir du spectacle. Jon M. Chu, la veut complexée par ce privilège, presque coupable, mais cette culpabilité n’est jamais explorée autrement que par des regards baissés et des chansons douloureusement propres. Glinda est l’image parfaite du “bon public” que le film présuppose : éveillée, empathique, mais pas trop perturbée, qui observe la souffrance des autres sans jamais avoir à la partager.
Elphaba, icône politique malgré elle
La seule vraie subversion vient d’Elphaba. Pas tant parce que le film la veut militante, mais parce que Cynthia Erivo la joue comme une femme que la société fabrique comme menace, puis qui finit par incarner cette menace pour survivre. Face au contrôle médiatique, aux manipulations d’État, au racisme institutionnel, Elphaba ne trouve pas de place « acceptable ». Alors elle prend la fuite, et le pouvoir, comme elle peut. C’est le geste féministe et post-colonial le plus sincère du film : le refus de l’intégration dans un système conçu pour écraser. Mais là encore, Hollywood referme la cage au moment même où le personnage commence à déranger.
Cynthia Erivo porte Elphaba avec une intensité rare : une héroïne contrainte de devenir l’emblème que la société projette sur elle. La réalisation veut montrer comment une femme marginalisée, racisée, différente, perçue comme “autre”, se voit assignée à un rôle qu’elle n’a pas choisi. On touche là à quelque chose de puissant, presque universaliste. Mais le récit recule systématiquement, et transforme la radicalité de son personnage en geste symbolique plutôt qu’en expérience politique.
Un conte engagé dépolitisé par le spectacle
Ce second volet parle de domination, de propagande, de discrimination raciale, de sororité, mais il le fait avec la retenue d’un studio qui veut flatter tous les publics, y compris ceux qui détestent qu’on leur parle de politique. Le résultat donne un film progressiste comme un manuel scolaire : impeccable sur le fond, inoffensif dans la forme, qui veut dénoncer l’oppression mais hésite à déranger. Féministe et qui gomme les angles les plus rugueux du patriarcat, post-colonial, mais qui préfère l’allégorie au conflit réel. En somme, une œuvre sincère, lissée, mais qui ne brûle pas. Un spectacle somptueux, un objet pop parfaitement maîtrisé, qui se regarde avec facilité, mais qui hésite à utiliser sa propre magie pour éclairer autre chose que son ambition commerciale.