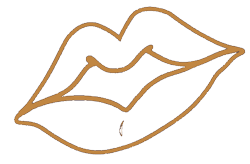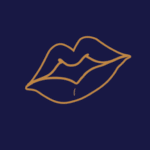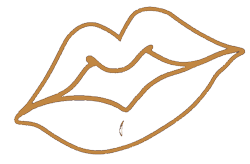Dimanche 8 février 2026, pendant que l’Amérique se gavait d’ailes de poulet, de paris sportifs et d’images patriotiques, la plus grande messe médiatique de la planète a déroulé son rituel. Un match, qui a opposé les New England Patriots aux Seattle Seahawks, Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile et Coco Jones pour la liturgie d’avant-match. Depuis Janet Jackson, son sein dénudé jusqu’à Beyoncé et son Black Power mainstream, en passant par le genoux à terre de Colin Kaepernick, le Super Bowl n’est plus un match : c’est une tribune. Et cette année, c’est Bad Bunny qui entre dans l’arène, et avec lui une Amérique latino, militante, bruyante, qui refuse de se taire.
Chaque année, le Super Bowl raconte l’Amérique telle qu’elle se fantasme : patriote, capitaliste, unifiée.
Et chaque année, un artiste vient fissurer ce récit, rappeler les fractures, les minorités, les tensions. Le choix de Bad Bunny, couronné du Grammy Awards du meilleur album de l’année comme tête d’affiche, a provoqué une onde de choc bien au-delà du sport et de la musique. Le Portoricain, premier artiste latinophone solo à occuper ce rôle mythique, a bâti sa carrière sur une revendication assumée de ses racines et de son identité culturelle, répétant que ce show est « pour mon peuple, ma culture et notre histoire ». L’artiste portoricain qui ne chante qu’en espagnol, énervent les conservateurs américains, jusqu’à Donald Trump qui a qualifié ce choix de “terrible qui ne fait que semer la haine“.

Bad Bunny contre Trump : la mi-temps comme front culturel
Et voilà Bad Bunny surgissant, au milieu de champs de canne à sucre, décor tropical et mémoire coloniale compressée en un tableau instagrammable, déclenchant déjà l’ironie instantanée des réseaux : « S’agit-il d’une référence à la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe ? », demandait un internaute, rappelant que la canne à sucre n’est jamais qu’un paysage innocent et qu’elle porte avec elle l’histoire mondiale de l’esclavage, du sucre et du capitalisme, ce même capitalisme qui finance aujourd’hui la NFL.
Dans la foule des apparitions, Cardie B, Lady Gaga et Ricky Martin sont venus prêter main forte à la scénographie – comme si le halftime show, désormais, fonctionnait comme une ONU de la pop, où chaque star vient valider la centralité culturelle du moment, et où l’Amérique accepte soudainement le monde tant qu’il danse sur ses écrans géants. Et pendant que Bad Bunny transformait le stade en carnaval global, une autre Amérique ripostait.
Car derrière l’événement musical, le combat politique est bien réel. Bad Bunny a multiplié les prises de position contre Donald Trump et contre l’agence américaine de l’immigration (ICE), dénonçant les politiques de déportation et la peur instaurée dans les communautés latino-américaines.
Dimanche soir, la bataille s’est donc jouée sur le terrain et dans les salons, télécommande en main, chaque camp cherchant à s’approprier la liturgie médiatique la plus regardée de l’année. Car si le match a été officiellement diffusé par NBC et relayé sur plusieurs plateformes de streaming, la véritable fracture s’est produit à la mi-temps.
Les partisans de Donald Trump ont été explicitement appelés à zapper Bad Bunny pour rejoindre un spectacle parallèle, présenté comme « entièrement américain » par Turning Point USA, l’organisation ultraconservatrice fondée par le militant Charlie Kirk, figure centrale de la droite culturelle américaine, dont des extraits de discours ont été utilisés pour promouvoir ce concert alternatif. Kirk avait fait du Super Bowl un front stratégique de la guerre culturelle, un champ de bataille symbolique où se joue la définition même de l’identité nationale.
Le programme annoncé est sans détour, « célébrer la foi, la famille et la liberté », un triptyque conservateur décliné comme une contre-programmation idéologique à la mi-temps de Bad Bunny, jugée trop latino, trop woke, trop politique. Pour incarner cette Amérique alternative, quatre artistes réputés proches de Trump ont été choisis, dont Kid Rock, vieux compagnon de route du trumpisme culturel, ainsi que plusieurs figures de la country, dont Brantley Gilbert, connu pour son militantisme pro-armes, et la chanteuse Gabby Barrett, qui s’était produite à la Maison Blanche lors du concert de Noël de 2018, au cœur du premier mandat Trump.
Ainsi, pendant que Bad Bunny chantait en espagnol devant plus de cent millions de téléspectateurs, une autre Amérique s’est rassemblée devant un concert parallèle, sanctuarisé, patriote, chrétien, comme un contre-Super Bowl culturel, révélant à quel point la mi-temps n’est plus un simple divertissement mais une ligne de fracture, un référendum esthétique et politique, où même le choix d’un chanteur devient un acte partisan.
Quand le Super Bowl devient une tribune politique
Depuis longtemps, la mi-temps du Super Bowl est un miroir grossissant des tensions américaines. Tout bascule véritablement en 2004, lorsque Janet Jackson et Justin Timberlake offrent à l’Amérique un demi-seconde de panique morale : un sein dévoilé, aussitôt baptisé nipplegate, qui déclenche une hystérie puritaine, des sanctions de la Federal Communications Commission, une télévision soudain corsetée, et l’idée que la mi-temps du Super Bowl n’est plus un simple divertissement, mais un espace de pouvoir, donc de contrôle.
À partir de là, chaque artiste comprend que cette scène est une tribune. Beyoncé, en 2013, s’en empare avec la maîtrise d’une stratège culturelle, en transformant le halftime show en proclamation féministe grand public, annonce l’ère Lemonade et impose le corps noir, féminin, souverain, au centre d’un spectacle historiquement pensé pour le regard blanc et masculin.
Trois ans plus tard, en 2016, elle radicalise encore le geste, convoquant Formation, les bérets noirs façon Black Panthers et la mémoire des luttes afro-américaines, dans une Amérique encore secouée par les émeutes de Ferguson et Baltimore. La pop devient un manifeste, la chorégraphie un éditorial, et Fox News découvre que le Super Bowl peut être un champ de bataille idéologique.
Même Rihanna, enceinte et silencieuse politiquement en apparence, avait fait de son retour une affirmation féministe et une démonstration de pouvoir artistique autonome, tandis que Shakira et Jennifer Lopez, en 2020, avaient rappelé l’existence d’une Amérique bilingue, métissée et latino.
Puis vient 2022, l’apothéose hip-hop : Kendrick Lamar, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, un panthéon noir dans un stade majoritairement blanc, et Eminem qui s’agenouille sur scène, malgré les réticences de la NFL, rappelant Colin Kaepernick et les violences policières. La NFL découvre alors qu’elle ne peut pas contrôler totalement les symboles qu’elle commercialise, et que la ligue n’est jamais qu’un metteur en scène dépassé par ses propres symboles.
Kendrick Lamar, l’an dernier, avait une nouvelle fois, transformé la scène en fresque sur l’identité noire, la violence policière et l’histoire afro-américaine, dans la lignée de Beyoncé.
Et nous voilà en 2026, avec Bad Bunny, premier Portoricain en tête d’affiche solo, chantant en espagnol dans une Amérique trumpiste obsédée par la frontière, la langue et l’identité, transformant la mi-temps en manifeste latino, et rappelant qu’un refrain peut parfois faire plus pour la visibilité d’une minorité qu’un discours de campagne.
Le genou à terre qui a fait trembler l’Amérique conservatrice
Et puis il y a eu le genou à terre de Colin Kaepernick, un séisme national, qui a fissuré la mythologie patriotique. En août 2016, le quarterback des San Francisco 49ers décide de ne plus se lever pendant l’hymne américain, puis, quelques jours plus tard, pose un genou à terre, expliquant qu’il refuse de « se tenir debout pour montrer de la fierté pour un drapeau qui opprime les personnes noires et les personnes de couleur ». Le geste est calme, presque modeste, mais l’Amérique s’embrase : Donald Trump parle d’un « son of a bitch », les supporters brûlent des maillots, les chaînes info hurlent au sacrilège, et la NFL découvre que le sport n’a jamais été un refuge apolitique, seulement un espace où l’on avait appris à taire la politique.
Kaepernick ne rejouera plus en NFL, et devient une la figure sportive contre les violences policière et celui du prix à payer pour contester l’ordre établi, tandis que Nike transforme son visage en icône marketing avec ce slogan paradoxal : « Croyez en quelque chose. Même si cela implique de tout sacrifier.»
Son genou à terre, repris par des dizaines de joueurs, des lycéens, des sportifs du monde entier, a ouvert une brèche irréversible : il a fait entrer Black Lives Matter dans les stades, rappelé que l’hymne est aussi une fiction politique, et peut être interrompue par un corps qui refuse de jouer le jeu.
Depuis, chaque Super Bowl porte la trace de ce geste, comme une ombre portée : chaque chorégraphie, chaque discours, chaque silence est interprété à l’aune de ce genou posé à terre, qui a transformé un sport en tribune et un stade en agora politique.
La mi-temps, soft power et guerre culturelle
Pourquoi tant d’enjeux autour de treize minutes de musique ? Parce que le Super Bowl est un outil de soft power unique : plus de 130 millions de téléspectateurs l’an dernier, une audience mondiale, et une amplification instantanée sur les réseaux sociaux. Les artistes y gagnent une explosion de streams et de ventes, parfois multipliés par six, preuve que ce rituel est autant une machine capitaliste qu’un moment culturel.
Trump, paradoxalement, est l’enfant du spectacle télé. Il a gagné une présidence grâce à la télé-réalité, aux punchlines et à la culture virale. Et voilà que la pop, devenue elle-même un média politique, l’attaque sur son terrain, avec plus d’audience, plus de glamour, et moins de fact-checking.
Bad Bunny, en chantant en espagnol devant des millions d’Américains, fait plus pour la visibilité latino que n’importe quelle réforme symbolique. Il rappelle que l’Amérique n’est pas seulement blanche, anglophone et nostalgique, mais aussi caribéenne, migrante, bilingue, mondialisée.
La NFL de son côté continue de jurer qu’elle est apolitique, mais le show, lui, raconte autre chose : qu’il est devenu le baromètre idéologique le plus spectaculaire de l’Amérique contemporaine, celui où l’on mesure chaque année, à coups de drones, de chorégraphies et de paillettes, l’état de ses fractures, de ses obsessions et de ses fantasmes.