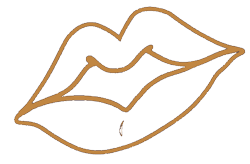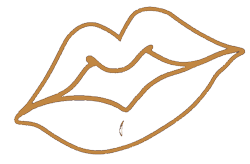Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, sous un ciel zébré d’explosions et de sons de sirènes, les forces armées des États-Unis ont frappé Caracas. En quelques heures, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé, transféré hors du pays et placé en détention, au terme d’une opération aérienne et terrestre nommée Operation Absolute Resolve.
Les États-Unis annoncent vouloir « assurer une transition sûre » pour le Venezuela et visent désormais ses champs pétrolifères. Mais pour les experts, derrière le narratif moral, se profilent des intérêts géopolitiques, des leçons non tirées de l’histoire américaine et la réitération d’un rêve vieux de plusieurs décennies.
Un président pris dans la traque : l’Amérique et ses obsessions
L’histoire de l’intervention américaine au Venezuela ressemble à un scénario hollywoodien, elle aurait d’ailleurs pu être signée par l’équipe de Zero Dark Thirty (2012), un thriller de Kathryn Bigelow qui suit la décennie de traque de Oussama ben Laden, menée par la CIA jusqu’à son élimination en mai 2011 dans Abbottabad, au Pakistan. Mais l’opération sur Caracas n’a rien de fictionnel, elle s’inscrit dans une longue tradition d’interventions américaines motivées autant par des intérêts stratégiques que par des justifications morales, la plupart du temps présentées au public comme des « actions nécessaires » contre des régimes qualifiés de « dictatures ».
Après l’invasion de l’Irak le 20 mars 2003, sous l’administration de George W. Bush, l’armée américaine lance une vaste chasse à l’homme. L’opération prend des airs de western militarisé avec perquisitions nocturnes, interrogatoires, réseaux d’informateurs, frappes ciblées. La traque culmine le 13 décembre 2003, près de Ad-Daour, au sud de Tikrit, lorsque Saddam Hussein est retrouvé dissimulé dans une cache souterraine — une « spider hole » — au cours de l’opération Red Dawn menée par la 4e division d’infanterie et les forces spéciales. L’image est même devenue iconique, le dictateur irakien, barbe fournie, abasourdi sous la lumière crue d’une lampe frontale. Washington avait évoqué la justice, la sécurité mondiale, et l’ordre retrouvé, mais derrière le discours moral affleurait déjà l’autre vérité à savoir le contrôle stratégique d’une région pétrolière clé, la recomposition d’un État au forceps, et un chaos politique dont l’Irak ne se relèvera jamais complètement.
La traque de Saddam a d’ailleurs façonné l’imaginaire hollywoodien autant que la doctrine militaire américaine, et irrigué des œuvres comme : The Hurt Locker (2008), film de Kathryn Bigelow également, où la guerre devient une addiction. Green Zone (2010), réalisé par Paul Greengrass, dont l’action se situe à Bagdad en 2003, et qui relate les manipulations politiques et les mensonges entourant les armes de destruction massive. Et enfin American Sniper (2014), de Clint Eastwood qui retrace l’histoire de Chris Kyle (Bradley Cooper), membre des Navy SEAL, et surtout l’un des tireurs d’élite les plus redoutables de l’histoire américaine.
Hantises historiques : Cuba, la Baie des Cochons et une politique qui ne meurt jamais
Retour en arrière. La Baie des Cochons (1961). Sous l’administration de John F. Kennedy, la CIA orchestre une invasion de Cuba par des exilés anti-castroistes pour tenter de renverser Fidel Castro. L’opération échoue de manière spectaculaire, et devient un symbole d’arrogance stratégique américaine. Plus tard, la guerre du Vietnam qui a vu la défaite des Américains est venue enfoncer encore plus profondément l’idée que les engagements extérieurs, même sous couvert de « lutte contre le communisme », pouvaient devenir des bourbiers tragiques.
Une décennie en arrière, en Iran (1953), la CIA (Operation Ajax) reconnait le coup d’État de contre le Premier ministre Mohammad Mossadegh, après sa décision de nationaliser l’industrie pétrolière pour réinstaller le Shah pro-occidental. Au Guatemala (1954), l‘Operation PBSuccess renverse le président Jacobo Árbenz, dont les réformes foncières menaçaient les intérêts de la United Fruit Company. Au Chili (1970–1973), la CIA, via Project FUBELT, s’oppose à l’élection de Salvador Allende et soutient le climat qui mènera au coup d’État de 1973 mené par Augusto Pinochet. Dix ans plus tard, au Brésil (1964), les États-Unis encouragent le coup qui renverse João Goulart et installe une dictature militaire. Depuis lors, chaque président américain, démocrate ou républicain, a porté dans un coin de son esprit la même idée : faire tomber un régime qu’il juge hostile ou incompatible avec ses intérêts. Cette obsession collective n’a pas disparue avec Trump, elle s’est même transformée en une politique agressive de pression, d’ingérences et, aujourd’hui, d’interventions directes.
Un décompte réalisé pour l’Amérique latine estime que 41 changements de gouvernement ont été provoqués ou influencés par les États-Unis entre 1898 et 1994, souvent sous le prétexte de lutte contre le communisme ou de protection d’intérêts économiques. Le livre Overthrow: America’s Century of Regime Change from Hawaii to Iraq (Stephen Kinzer, 2006) documente près d’une quatorzaine de gouvernements renversés par Washington au cours du XXᵉ siècle (Hawaii, Iran, Guatemala, Cuba, Panama, Philippines, Nicaragua, Honduras, Chine, Afrique, etc.).
Ces épisodes forment un continuum historique dans lequel les États-Unis ont utilisé des moyens variés, coups d’État, actions couvertes de la CIA, soutien à des oppositions armées, pression politique ou économique, pour remodeler des gouvernements jugés hostiles ou incompatibles avec leurs intérêts. Elles dépassent largement les seules affaires de Cuba ou du Vietnam ; de l’Iran au Congo, du Guatemala au Chili, la même logique est celle de la traque ou l’éviction de dirigeants supposés contraires à la “sécurité américaine” ou à ses intérêts économiques.
Trump et l’Amérique qui voulait rester chez elle… avant de conquérir le monde
Pourtant lors de sa première campagne (2016), Donald Trump promettait de recentrer les États-Unis sur leurs propres besoins, le fameux slogan America First. Mais son second mandat, a transformé cette rhétorique en impulsions expansionnistes, avec notamment des pressions et tensions accrues sur le Canada, allant jusqu’à affirmer qu’il utiliserait la « force économique », et non militaire, pour annexer son voisin. Plus tard ce sont des tentatives de discussions autour du Groenland, que le président américain voulait acheter, stratégie qui remonte à plus d’un siècle. Et maintenant une offensive militaire directe sur le territoire d’un pays souverain en Amérique latine. La capture de Maduro n’est pas seulement une « décapitation » politique ; c’est une narration américaine de domination stratégique qui, immédiatement, infiltre les médias, les gouvernements et même l’imaginaire populaire. Donald Trump ne se contente plus de projeter de la puissance, il veut l’imposer, à des alliés, et surtout à ses adversaires.
Les Vénézuéliens souhaitaient la fin du régime, mais pas comme ça
Au Venezuela, la haine de Maduro n’avait rien d’un secret d’État. Des files d’attente devant les supermarchés vides aux exils par millions, une partie du pays rêvait d’une transition, d’élections crédibles, d’un retour à la respiration démocratique. D’après Amnesty France, sous son gouvernement, au pouvoir depuis 2013 après la mort de Hugo Chávez, de larges pans de la population dénonçaient une spirale de répression, d’effondrement économique, de violation des droits humains et de fraude électorale avec des arrestations massives d’opposants, répression des manifestations, emprisonnements arbitraires et utilisation de la force meurtrière par les forces de sécurité sont documentés depuis plusieurs années.
Selon le site WOLA des sondages ont démontré qu’une majorité de Vénézuéliens soutenait l’idée que Maduro doit partir, mais pas par une intervention militaire étrangère, et seulement environ 35 % se déclaraient prêts à appuyer une intervention militaire externe pour le déloger, tandis que plus de la moitié s’y opposaient fermement. À l’opposé, toujours selon WOLA, une large part de la population préfère une sortie politique négociée, par un processus démocratique, des élections libres et crédibles, ou une transition interne plutôt qu’une intervention armée pilotée par une puissance étrangère. Un retrait graduel négocié de Maduro, par exemple, recueille un soutien populaire beaucoup plus net que l’idée d’un débarquement ou d’une opération militaire extérieure.
Cette nuance est essentielle parce que dans le cœur de nombreux Vénézuéliens, même opposants à Maduro, l’idée de défendre leur souveraineté nationale reste primordiale. Ils ne veulent pas remplacer une oppression par une domination étrangère. Dans des contextes de crise, ce type de changement nourrit souvent de nouveaux ressentiments, de nouvelles fractures sociales, et parfois de nouveaux cycles de violence. Même les appels à la mobilisation de la classe politique venue de l’opposition, comme par exemple María Corina Machado ou d’autres figures politiques, ont toujours insisté sur une transition pacifique, des élections crédibles et la légitimité populaire pour déterminer l’avenir du pays.