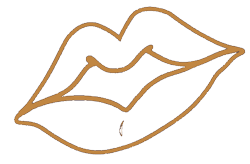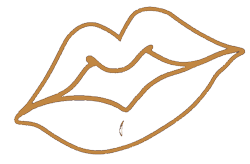Oui, j’ai gravi les 424 marches de Notre-Dame (et mes mollets s’en souviennent). Jeudi soir encore, j’hésitais. Et pour tout vous dire, je n’avais pas prévu de jouer les pèlerines ce samedi. Mais les Journées du patrimoine, c’est un peu comme un coup de fil d’une vieille amie : on se dit qu’on n’a pas le temps, puis on finit par céder. Alors me voilà, carnet sous le bras, sur le parvis de Notre-Dame, à faire la queue comme tout le monde. Les tours rouvrent au public, et je ne pouvais pas rater ça.
Premier constat : il y a du monde. Beaucoup. Les créneaux sont complets depuis des jours. La cathédrale est redevenue star de Paris depuis sa réouverture. Il parait qu’il y a huit millions de visiteurs en un an, mais devant les barrières, ce matin, c’est la Tour de Babel, plus que les Tours de Notre-Dame. Je n’entends que des langues mélangées, espagnol, anglais, japonais. Moi, je suis juste une Parisienne qui a décidé d’aller voir de près ce qui se cache derrière les échafaudages.
Les 424 marches commencent comme une blague. « Ça ira », je répète, bravache, à une voisine de file qui chausse des ballerines confortables. Vingt minutes plus tard, je m’accroche à la rampe comme une vieille dame. L’escalier en colimaçon n’a aucune pitié.
Erreur. Dès la centième marche, mes cuisses protestent. L’escalier en colimaçon avale les visiteurs comme une spirale sans fin. Mais j’avoue que ça me fait quelque chose : le parfum de résine et de poussière, le silence qui grince sous nos pas. Moi, je le gravis en pestant contre mes mollets, mais c’est trop beau.
Après l’effort, le réconfort, la récompense : une forêt de bois au cœur du beffroi. Je croyais avoir tout vu de Notre-Dame, mais non. Les poutres craquent, l’odeur de résine est encore là, et je pense aux charpentiers de 26 ans de moyenne d’âge qui ont bâti cette merveille. Philippe Villeneuve, l’architecte en chef, les appelle « une belle jeunesse ». Pour une fois, je veux bien le croire.
Au cœur de cette forêt, un ovni, l’escalier à double révolution, cet objet mathématique en chêne massif, un monstre de chêne monté pièce par pièce par cette bande de charpentiers à peine sortis de l’adolescence. On monte, on descend, sans jamais se croiser. Un petit miracle en bois. Mes mollets crient grâce, mais mes yeux, eux, s’ouvrent grands.
Arrive Emmanuel. Non pas Macron, je vous vois déjà pouffer de rire. Emmanuel, ce n’est pas non plus un guide touristique ou un compagnon charpentier, c’est le nom de la plus grande cloche de Notre-Dame de Paris. Son nom complet est Emmanuel-Louise-Thérèse. Elle date du XVe siècle (refondue en 1686 sous Louis XIV).



Et détail qui fait frissonner : lors de l’incendie du 15 avril 2019, si le feu avait atteint les jougs qui maintiennent Emmanuel et les autres cloches, la tour aurait pu s’effondrer avec tout l’édifice. La voilà, enfin. Treize tonnes de bronze, rescapé du feu.
On ne parle plus, on chuchote. Les selfies attendront. À ce moment précis, je me sens minuscule et fière d’être là. Suspendue là, majestueuse, presque vivante. On pense aux pompiers de 2019, à ce fil qui a tenu la cathédrale debout. On se tait. Quelques selfies vite faits, mais personne ne parle fort.
Encore quelques marches et Paris surgit, immense. Les gargouilles m’observent, moqueuses. La flèche, ressuscitée, se dresse à hauteur d’homme. Et en bas, la ville, ma ville : la Seine qui découpe l’île, la Tour Eiffel plantée comme une allumette au loin, les toits gris qui s’étendent comme une mer.
En redescendant, je me demande si ça valait mes courbatures, je souris. Oui, ça valait la peine. Oui, mille fois oui. Parce qu’ici, on ne visite pas seulement une cathédrale, on traverse un morceau d’Histoire, la nôtre, encore fumante. Et surtout pour retrouver ce qu’on croyait perdu, et se rappeler qu’un monument, c’est aussi un peu de nous.
Alors, pour ceux qui hésitent encore : foncez. Mais réservez, sauf le vertige. Parce que Notre-Dame de Paris est un symbole du patrimoine historique français ouvert librement et gratuitement,
Plus d’infos :
Attention aux faux billets payants, l’entrée est 100 % gratuite et réservée uniquement via le site officiel. Aucune plateforme tierce n’est habilitée à la vendre. Aucun billet ne peut être vendu ou distribué par un guide ou une agence. Notre-Dame est un lieu de prière ouvert à tous, librement et gratuitement
depuis 860 ans, seuls les dons sont acceptés.
Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi
7h50 – 19h
jusqu’à 22h le jeudi
Samedi et dimanche
8h15 – 19h30
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture des portes.
Crédits photos : Notre-Dame de Paris