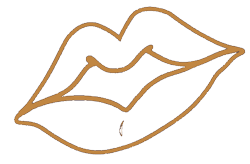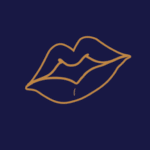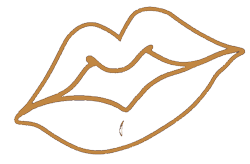Avec Avatar : De feu et de cendres, en salle depuis le 17 décembre, James Cameron ne filme plus seulement une planète agressée, mais un monde déjà ravagé. La fable écologique se durcit, se politise autrement. Derrière les volcans de Pandora grondent les mines de lithium, les forêts sacrifiées à la transition verte, les terres autochtones rendues inhabitables au nom du progrès. Le feu n’est pas une métaphore : il est le résultat d’un système. Et sous les cendres cinématographique de Cameron, ce n’est pas la nature qui s’effondre seule, mais un rapport de domination vieux comme le capitalisme. Pandora parle d’écologie, mais surtout de pouvoir, de spoliation et de ceux qui paient le prix du désastre pendant que d’autres comptent les bénéfices.
En 2009, James Cameron nous invitait pour la première fois au cœur de Pandora, planète luxuriante peuplée des Na’vi, pour une fable spectaculaire opposant l’ambitieux marine Jake Sully à la colonisation industrielle humaine. Ce premier Avatar fut, sans trop d’exagération, un séisme visuel et commercial : premier film à dépasser largement les 2 milliards de dollars de recettes mondiales.
Treize ans plus tard, en 2022, Avatar : La voie de l’eau prolongeait la saga avec la même famille Sully, désormais confrontée aux océans de Pandora et à l’agression persistante des « Hommes du Ciel ». Là encore, le blockbuster fut un triomphe visuel (nombreuses nominations et prix techniques), mais pour plusieurs critiques, moins un cinéma émotionnel qu’une machine à effets.
Pandora et l’écologie : une saga revendiquée
Dès Avatar (2009), James Cameron a fait de Pandora une métaphore environnementale : un écosystème relié comme un corps unique, où chaque espèce influence les autres, et où la moindre extraction de ressources n’est jamais neutre. Ce leitmotiv, celui d’une nature « vivante » et sacrée, fut l’un des moteurs de la saga, souvent interprété comme une critique de l’exploitation capitaliste et coloniale des ressources.
Avatar : La voie de l’eau (2022) avait déployé ce message vers l’élément marin, explorant les océans et leur biodiversité tout en dénonçant pollution, surexploitation et déséquilibres. L’écologie y était non seulement thématique mais incarnée dans l’intrigue familiale.
Avec De feu et de cendres, Cameron change un peu d’angle. Le film nous transporte dans des biomes volcaniques extrêmes de Pandora, dominés par une tribu appelée les Mangkwan, tribu forgée par la destruction naturelle et la violence de son environnement.
Sur le plan écologique, ce troisième volet shift moins vers la dénonciation directe de l’industrialisation humaine (le thème central des deux premiers) que vers une tension intérieure à Pandora elle-même : destruction, adaptation, résilience. Là où auparavant la menace venait surtout de l’extérieur (les humains), maintenant les forces du feu et de l’érosion interne deviennent des protagonistes narratifs à part entière. L’écologie se confond avec des notions de deuil, de responsabilité et de coexistence avec l’imprévisible, plutôt que de simplement condamner l’exploitation humaine.
Troisième acte : feu, cendres… et incertitudes
Avatar : De feu et de cendres ouvre sur les cendres encore chaudes de la tragédie familiale Sully, le deuil de Neteyam, fils aîné disparu dans le précédent opus, et sur une pandémie de violence qui ne s’éteint pas. Le film introduit une nouvelle tribu Na’vi, les Ash People, aux allures de guerriers volcaniques, et une antagoniste charismatique, Varang, jouée par Oona Chaplin, dont la rancœur ravive les braises d’un conflit tribal. Sur le papier, il y avait matière à densifier les thèmes déjà effleurés par Cameron : le deuil, l’identité, l’ombre et la lumière de toute civilisation. Mais à l’écran, l’équilibre se révèle délicat.
Pandora, miroir colonial
Il faut dire que depuis 2009, Avatar n’a jamais vraiment parlé d’extraterrestres. Il parle surtout de nous, de la Terre vue depuis ses colonies. De l’Occident industriel regardé depuis le point de vue de ceux qui subissent. Pandora, planète convoitée pour ses ressources, fonctionne comme une allégorie transparente de l’extractivisme contemporain : on y débarque pour extraire, sécuriser, rentabiliser, et tant pis si ça détruit tout sur son passage. Dans le premier opus, l’équation était simple, presque naïve : les humains = colonisateurs, les Na’vi = peuples autochtones.
Une grille de lecture directement transposable aux réalités bien terrestres : Amazonie grignotée par les mines, terres autochtones sacrifiées au nom de la “transition”, pipelines imposés par la force. Cameron filmait Pandora comme on filme un territoire occupé.
Du bulldozer au volcan : changement de focale
Avec De feu et de cendres, le film opère un glissement politique plus subtil, et plus dérangeant. La violence ne vient plus seulement de l’extérieur. Elle surgit de l’intérieur même du monde vivant. Les terres brûlent, les équilibres se fissurent, les alliances se fragmentent. Derrière cette évolution narrative, une question très actuelle : et si la crise écologique n’était plus seulement une agression, mais aussi une réaction ? Pandora serait alors une métaphore du climat déréglé, de la planète qui ne répond plus comme avant. Sécheresses, incendies, éruptions, tempêtes : la nature n’est plus un Eden violé, mais une force instable, parfois hostile. Comme sur Terre.
Écologie sans coupable ?
En montrant une Pandora qui brûle d’elle-même, Cameron prend le risque d’un glissement idéologique : celui d’une écologie où la responsabilité humaine devient diffuse, presque secondaire. Or, dans le monde réel, les catastrophes ne sont pas spontanées. Les mégafeux ont des causes. Les pénuries d’eau aussi.
Les déplacements de populations encore plus.
À force de mythologiser la crise écologique, Avatar 3 semble parfois désamorcer la question centrale du pouvoir : qui décide ? qui profite ? qui paie ? Et comment vivre avec une nature qui nous dépasse, qui n’est pas juste une victime mais une force complexe ?
Peuples autochtones : toujours en première ligne
Reste une évidence, comme sur Terre, ce sont les peuples les plus proches de la nature qui encaissent le choc. Les Na’vi volcaniques, façonnés par un environnement hostile, rappellent ces communautés contraintes de vivre sur des terres dégradées, zones polluées, territoires sacrifiés, régions rendues inhabitables par l’économie mondiale.
On pourrait citer le cas des communautés autochtones et rurales vivant le long du fleuve Nanay, dans l’Amazonie péruvienne, qui ont accusé l’État de ne pas stopper l’orpaillage illégal, qui pollue leurs rivières et leur poisson avec du mercure, une substance hautement toxique. Cette contamination met en péril leur santé, leur subsistance et leurs droits fondamentaux.
Par exemple, au Mexique, des habitants en aval d’installations industrielles vivent avec des eaux et des terres polluées, entraînant maladies et contamination des ressources alimentaires. Autres formes d’injustice environnementale, des « sacrifice zones » urbaines comme Cancer Alley aux États-Unis montrent que des populations à faibles revenus, souvent racisées, subissent des niveaux extrêmes de pollution industrielle, avec des taux élevés de cancers et de maladies respiratoires liés à l’environnement. Sur Pandora comme en Amazonie, au Sahel ou dans l’Arctique, l’écologie n’est jamais abstraite.
Elle est sociale, raciale, politique.
Une fable verte à l’heure du capitalisme vert
Le paradoxe, c’est qu’Avatar dénonce l’extraction tout en étant l’un des produits les plus coûteux et énergivores de l’industrie culturelle. Le film de James Cameron critique un système dont il dépend. Comme nos sociétés, coincées entre conscience écologique et dépendance structurelle. Pandora porte une symbolique forte, un écosystème vivant, attaqué de l’extérieur et en proie à sa propre forme de crise, mais dans le monde réel, ce sont des personnes réelles qui vivent dans des environnements équivalents à des « zones de sacrifice », souvent parce que des intérêts économiques ont pris le pas sur les droits humains et la santé planétaire. C’est peut-être là que De feu et de cendres touche juste, malgré ses ambiguïtés : la crise n’est plus seulement morale, elle est systémique. Et il n’y a plus de solution simple, ni de grand méchant clairement identifié.
Cameron essaie de pousser sa parabole écologique plus loin que l’opposition binaire homme/Na’vi, en suggérant que la violence et la peur naissent aussi de l’intérieur, que l’ennemi peut être multiple et insaisissable. Mais sur grand écran, ce message vibré à grands coups d’effets spectaculaires se heurte parfois à l’épaisseur narrative elle-même.
Avatar : De feu et de cendres est un objet cinématographique fascinant et frustrant tout à la fois qui ne renie pas l’écologie, mais la redéfinit. Un chef-d’œuvre technique indéniable, peut-être un peu trop conscient de son statut d’événement, et qui peine à renouveler pleinement l’émotion profonde promise par la saga. Elle ne s’adresse plus autant à la défense d’un Eden en péril contre des bulldozers humains, mais à une méditation plus vaste sur l’entrelacement de la vie, de la mort et de la perte au sein même d’un monde vivant. C’est une écologie plus intellectuelle, plus cyclique, peut-être moins revendicative, et pour certains, moins puissante politiquement.
Sources :