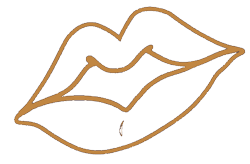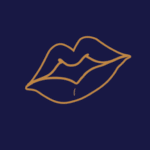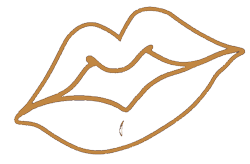Avec Furcy, né libre, en salles en France hexagonale le depuis le 14 janvier, Abd al Malik prolonge un mouvement encore fragile mais décisif du cinéma français : celui qui consiste à regarder frontalement l’histoire de l’esclavage et de son abolition, non comme un simple décor du passé colonial, mais comme une matrice politique, juridique et morale de la France contemporaine. Après Ni chaînes ni maîtres de Simon Moutaïrou, et bien avant eux Case départ de Fabrice Éboué, ces films, pourtant très différents dans leur forme, s’attaquent au même silence.
Un silence d’autant plus assourdissant que, de l’autre côté de l’Atlantique, la mémoire noire est aujourd’hui frontalement remise en cause, laissant au cinéma l’une des dernières fonctions de transmission.
Un vide français, longtemps assumé
Il aura fallu attendre 2001, avec la loi portée par Christiane Taubira, pour que la France reconnaisse officiellement la traite négrière et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. Un acte fondateur, mais qui n’a pas immédiatement trouvé son prolongement dans le cinéma, pourtant l’un des outils majeurs de fabrication de l’imaginaire collectif.
Là où le cinéma américain s’est saisi très tôt de cette mémoire, de Roots (1977) à 12 Years a Slave de Steve McQueen (2013), en passant par Amistad de Steven Spielberg (1997), la production française a longtemps contourné le sujet, comme si l’histoire esclavagiste demeurait périphérique au récit national, cantonnée aux marges scolaires ou universitaires.
Trois films, une même brèche
Case départ (2011), Ni chaînes ni maîtres (2024) et Furcy, né libre (2025) n’ont ni le même ton, ni la même ambition esthétique, ni la même stratégie narrative. Pourtant, tous trois travaillent le même point de rupture : la transmission d’une histoire longtemps tue.
Avec Case départ, Fabrice Éboué et Thomas Ngijol choisissaient la comédie et le voyage temporel pour raconter l’esclavage, s’attirant au passage un procès injuste : celui d’avoir osé le rire là où l’on attendait l’effroi. Mais cette audace révélait déjà un malaise français profond, comme si la gravité historique ne pouvait être abordée que dans une solennité pédagogique, validée par l’institution scolaire.
Ni chaînes ni maîtres, de Simon Moutaïrou, adoptait au contraire une mise en scène frontale, quasi épique, centrée sur la violence du système esclavagiste et sur la résistance des corps, inscrivant enfin l’histoire des esclaves dans un récit de lutte et de dignité, à hauteur d’hommes et de femmes.
Avec Furcy, né libre, Abd al Malik opère un déplacement essentiel, celui de raconter l’histoire vraie de Furcy Madeleine, né libre à La Réunion à la fin du XVIIIᵉ siècle, mais maintenu illégalement en esclavage pendant des décennies, avant de porter son combat jusqu’aux tribunaux français. Une histoire judiciaire, politique, intime, qui dit la violence administrative autant que la violence physique, et révèle la manière dont le droit a longtemps servi à légitimer l’injustice. L’esclavage n’est pas seulement une affaire de chaînes, mais aussi de droit, de décrets, de tribunaux, de codes juridiques, à commencer par le Code noir, omniprésent dans le film comme symbole d’un ordre légal profondément inégalitaire.
Furcy ou la mémoire par le droit
Furcy, né libre s’inspire librement avant et surtout du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui, qui retrace le combat réel de Furcy Madeleine, né libre par sa mère mais maintenu en esclavage à La Réunion au début du XIXᵉ siècle. En 1817, à la mort de cette dernière, Furcy découvre des documents attestant de son statut d’homme libre et engage une bataille judiciaire qui le conduira jusqu’en métropole.
Abd al Malik le répète : Furcy, né libre n’est pas d’abord un film sur l’esclavage, mais sur son dépassement, sur ce moment fragile où un système se fissure parce qu’un homme, dépossédé de toute force sociale, choisit paradoxalement l’arme la plus lente et la plus incertaine, le droit. En refusant le marronnage ou la violence, Furcy engage une bataille juridique qui oblige l’ordre colonial à se regarder lui-même, à affronter ses propres textes, ses décrets, ses contradictions. Pour le réalisateur, ce choix n’a rien d’un renoncement, il constitue au contraire un geste politique majeur, qui fait résonner le combat de Furcy avec notre présent, interrogeant l’État de droit, la patience comme stratégie de résistance, et la puissance du verbe face aux systèmes d’oppression.
Pendant ce temps, l’Amérique efface
Cette question du cinéma comme dernier refuge de la mémoire prend aujourd’hui une dimension particulière. Aux États-Unis, où la mémoire noire a longtemps trouvé dans la fiction un espace de reconnaissance, elle est désormais l’objet de contestations politiques. Restrictions budgétaires, retraits de livres des bibliothèques scolaires, remise en cause des programmes éducatifs consacrés à l’histoire afro-américaine, et menaces répétées sur des dispositifs symboliques comme le Black History Month, instauré en 1976, autant de signaux d’un recul assumé.
Dans ce contexte, le cinéma, la musique, la littérature, l’art contemporain, restent l’un des derniers bastions de transmission. Comme nous l’évoquions plus haut, de 12 Years a Slave de Steve McQueen (2013), à Amistad de Steven Spielberg (1997), en passant par Roots (1977) ou Django Unchained (2012), le cinéma américain a multiplié les récits, les points de vue, les formes, là où la France commence à peine à rassembler les siens.
En France, où cette mémoire n’a jamais occupé une place centrale, chaque film compte doublement, à la fois comme œuvre artistique et comme archive sensible. Furcy, né libre s’inscrit dans cette urgence, rappelant que l’histoire de l’esclavage n’est ni périphérique ni achevée, mais qu’elle continue de structurer nos rapports au droit, à l’égalité et à la citoyenneté.
Le cinéma comme archive vivante
Si Furcy, né libre est un film nécessaire, ce n’est pas seulement pour ce qu’il raconte, mais pour ce qu’il répare : une absence. À l’heure où les archives se ferment, où les livres disparaissent des rayonnages, et où l’histoire devient un champ de bataille idéologique, le cinéma demeure un outil de mémoire populaire, sensible, transmissible. Avec Case départ, Ni chaînes ni maîtres et Furcy, né libre, le cinéma français commence, lentement, à combler un vide qu’il a longtemps entretenu. Ces films ne disent pas la même chose, mais chacun à leur manière, ne disent pas seulement ce qui fut, mais interrogent ce que nous choisissons de regarder, d’enseigner, de transmettre. Et rappellent, avec insistance, que la mémoire de l’esclavage n’est ni un supplément d’âme, ni un sujet périphérique, mais une clé essentielle pour comprendre le présent. Les films demeurent parfois les seuls récits accessibles, partageables, incarnés. Et parce qu’il n’y aura jamais trop de films pour réparer des siècles de silence.